

"Il y a beaucoup de richesse, la plupart des bâtiments démolis ne sont pas insalubres et ont encore une durée de vie. "
Anne Lacaton est architecte et associée de l'agence Lacaton et Vassal qu'elle créée en 1984 avec Jean-Philippe Vassal.
Ensemble ils prônent une architecture économe et défendent la transformation plutôt que la démolition.
Ils sont lauréats en 2021 du Prix Pritzker
1-Qu’est ce qui vous a donné envie d’être architecte ?
Je ne suis pas sûre que je savais très bien ce qu’était le métier d’architecte.
J’avais fait le lycée dans les sections maths et on m’orientait plutôt vers des études d’ingénieur. J’aimais bien tout ce qui était technique, scientifique, mais j’aimais aussi les cours de dessin ou de musique, et intuitivement, il me semblait que les études d’ingénieur étaient très techniques et qu’il manquait une dimension plus créative, même si ceux qui font des maths à un niveau très élevé y trouvent de la créativité. Mais, je ne le voyais pas comme ça.
Quand j’ai eu le bac, je me souviens être allée à l’université de Bordeaux avec mes parents. Ma sœur y faisait des études de lettres. En faisant le tour des écoles, on s’était arrêté à l’école d’architecture de Bordeaux, tout juste construite.
Elle avait une forme bizarre. A l’époque ça m’avait plutôt attiré. Je n’avais pas du tout de position critique par rapport à ça.
Quand on m’a expliqué ce qu’étaient les études d’architecture ça a attiré ma curiosité et ça m’a semblé correspondre à comment je me projetais dans un métier.
Il y avait de l’histoire, du dessin, de la géométrie, des maths et de la physique, aussi, des langues, et du mouvement. J’avais l’impression de me retrouver dans toutes ces disciplines et c’est dans cette variété que j’imaginais ou espérais l’intérêt d’un travail.
Les études étaient passionnantes. On a étudié juste après 68. Il y avait un vent de liberté et d’expérimentation partout dans les écoles. On sentait que tout était possible. C’est un très bon souvenir forcément. C’était une époque beaucoup plus optimiste qu’aujourd’hui, qui invitait à la curiosité, Ca a beaucoup compté dans notre éducation et notre approche de l’architecture. Aujourd’hui encore on est curieux de savoir toujours plus.
Finalement ça n’a jamais démenti l’idée que je m’en faisais à 18ans.
Jean-Philippe et moi nous avons commencé en même temps. Il avait eu un parcours un peu différent puisqu’il a grandi à Casablanca. A l’époque c’était une ville très moderne, avec beaucoup de jeunes architectes européens partis construire là-bas, fuyant une Europe encore conservatrice. Pendant son enfance il était complètement baigné dans cette architecture moderne. Il dit que c’est ce qui lui a donné envie de devenir architecte.
2-Vous avez monté votre agence tout de suite après vos études ?
Non pas tout de suite.
J’ai commencé faisant quelques petits projets, un petit projet d’extension pour mes parents, puis pour une amie. Je travaillais aussi à l’agence de Jacques Hondelatte, cela a été important. Ensuite avec Arc en rêve à Bordeaux. Je connaissais les fondateurs depuis l’Ecole d’architecture. Ils avaient monté cette structure associative entre la pédagogie, la formation et la culture, dédiée au public. Tout ceci a été important et m’a permis de fabriquer une expérience multiple.
J’allais souvent aussi rendre visite à Jean Philippe au Niger, qui était parti là-bas pour la coopération*. C’est une autre expérience très forte, un moment déterminant dans la façon dont nous avons abordé l’architecture par la suite.
Le Niger a été une nouvelle école. Une école où rien ne ressemblait à ce que l’on avait appris. Au début on pensait que ce serait un temps de passage, une expérience temporaire. Au bout d’un moment on a compris l’intérêt et l’importance de ce que nous apprenions. Cela a été fondateur de notre manière d’aborder nos projets.
Je pense entre autres à la relation au climat. Que veut dire réellement « vivre avec son climat » ? C’est une question que l’on n’expérimente pas ici en France. Lorsque l’on parle du climat c’est dans une approche plutôt de protection ou sous un angle assez technique de l’économie d’énergie et du réchauffement climatique. Mais on se situe rarement dans l’approche plus naturelle et plus fondamentale qui est de « comment créer un rapport amical et positif avec son climat ? ». Quand on habite dans des pays chauds, avec peu de technologie à disposition, on est obligé de voir autrement, de s’accommoder et de trouver une façon de vivre avec.
La créativité et l’ambition avec peu, ce sont des principes que l’on a beaucoup appris au Niger, qui sont beaucoup moins présents dans notre éducation ou notre culture d’européen. « Qu’est-ce que c’est l’essentiel ? » C’est une question déterminante que nous avons apprise et qui nous suit dans la façon d’approcher nos projets ensuite.
* La France entretient avec le Niger des relations historiquement privilégiées. Les deux pays sont liés par de nombreux accords, dans les domaines de la coopération culturelle, judiciaire ou encore de la défense. Les contacts entre responsables politiques à haut niveau sont nombreux et les visites bilatérales régulières.
3-C’est de là qu’est née votre philosophie du projet fondé sur l’économie du projet et la générosité des espaces ?
Oui, l’économie, l’économie créative, qui permet la générosité. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’économie. L’économie est un moyen. Le moyen de faire plus avec ce que l’on a. Dans les projets, nous partons toujours du principe de la générosité de l’espace. « Qu’est-ce que on veut pouvoir faire dans un espace, sans se contraindre, sans se gêner ? L’économie, c’est ce qui permet de réaliser cette ambition de générosité d’espace.
On se méprend souvent sur ce que veut dire « économiser ». On pense que ça veut dire : faire moins, ou moins bien, se restreindre. Ce n’est pas comme ça que nous entendons l’économie. Pour nous il ne s’agit jamais de réduire, de restreindre. L’économie est notre moyen créatif et salutaire qui permet de ne jamais abandonner les ambitions de projet sur la générosité de l’espace, de la lumière, des usages.
4- Comment faire pour être généreux dans des programmes avec des PLU très restreints ?
Les PLU sont de plus en plus restrictifs.
Cependant, il y a beaucoup de projets où l’on s’aperçoit que le programme ne remplit pas les droits autorisés.
Il y a quelques années, nous avons fait une opération de logement rue de l’Ourcq à Paris. Nous ne remplissions pas le maximum autorisé par le PLU et pourtant nous avons réussi à être très généreux dans nos propositions d’espaces.
Mais chaque fois que les règles évoluent, elles entrainent souvent un peu plus de restrictions.
Par exemple, il y a eu une époque où les jardins d’hiver n’étaient pas comptabilisés dans la surface de plancher. Cela faisait partie de la surface HORS d’œuvre. Ça nous permettait de jouer avec la réglementation en optimisant à la fois le droit à construire sur un terrain, et de créer de l’espace supplémentaire. La nouvelle définition de la surface SPD a réduit cela et supprime cette possibilité.
Mais il faut quand même insister et suivre ses intentions. A travers les projets, on arrive parfois à faire évoluer les règlements. Je me souviens d’un projet à Mulhouse, avec le maître d’ouvrage, un bailleur social, nous avions le souhait mutuel d’agrandir largement les logements et de pouvoir faire des jardins d’hiver assez grands. Le projet a convaincu la mairie de modifier le règlement, sans que cela n’affecte le voisinage, ni les hauteurs.
C’est vrai qu’il n’y a pas un cas pareil et que ce n’est pas toujours possible, mais il faut essayer et on arrive parfois à faire aboutir des solutions.
L’espace généreux est pour nous essentiel dans la conception des projets. On observe bien souvent dans les programmes que tout est toujours pensé au minimum. Le logement, bien évidemment, mais les autres programmes aussi. On s’aperçoit que c’est le résultat d’un travail très long de compromis entre l’expression des besoins, et le prix au mètre carré qui fait l’arbitrage, sans savoir ce qu’un projet peut proposer. Ça part d’un principe que tout mètre carré est identique, coûte le même prix, et ce prix au mètre carré détermine la surface que l’on pourra construire dans le budget et ainsi le programme. Cette hypothèse de départ qui n’est pas du tout pertinente, ou en tout cas beaucoup trop sommaire.
Il faut changer complètement cette façon de calculer le prix des bâtiments qui reste vraiment ancrée et jamais remise en question. Evidemment la question économique doit être posée dès le départ et les limites de budget, mais il faut démonter l’idée que « si vous construisez plus, le bâtiment sera plus cher.
Il faudrait donner beaucoup plus de marge au concepteur. Des programmes plus ouverts, qui ne prédéterminent pas un projet, mais décrivent les besoins, de manière large, et donner un budget à respecter scrupuleusement.
Le premier projet que nous avons réalisé au début de notre agence, était une maison à Bordeaux. Ce projet a été pour nous un extraordinaire champ de recherche et de travail. On avait discuté avec la famille. On leur avait dit que nous voulions faire autre chose qu’une maison standard minimum. Nous étions très motivés pour faire une maison beaucoup plus grande, plus ouverte sur l’extérieur, où ils auraient plus de facilité d’usage au quotidien. Ensuite il fallait y arriver. Donc on a rassemblé tout ce que l’on avait dans la tête, en se donnant toute liberté. Se rappeler comment font les gens en Afrique quand ils n’ont pas beaucoup : ils vont à l’essentiel. Etudier comment font les grandes surfaces pour construire des bâtiments efficaces et pas chers. S’inspirer de la performance de bâtiments agricoles comme les serres, pour gérer le climat.
A travers tout ça, on a cherché à comprendre précisément comment se fait le calcul du coût, quels sont les paramètres qui constituent le coût d’un bâtiment et le rapport entre le projet et ce coût : la complexité, la facilité d’exécution, la rationalisation et l’optimisation des éléments de la construction. C’est beaucoup plus précis qu’un coût moyen généralisé au mètre carré qui ne tient pas compte de la particularité d’un projet. Il faut être dès le début extrêmement précis et distinguer les choses par élément pour arriver à faire jouer les leviers. Ce premier projet a été vraiment très formateur pour nous.
5-D’où vient l’utilisation des matériaux industriels, verre, polycarbonate …
Ces matériaux souvent très performants, efficaces et économiques, par leur production en grande série, nous permettent de réaliser ce que l’on veut mettre en œuvre : des espaces plus grands, qui offrent plus possibilités, des grandes façades transparentes qui laissent passer la lumière et la vue, de la transparence et de la vue, des protections solaires ou thermiques efficaces, etc, que l’on ne pourrait pas réaliser avec des matériaux sur mesure. Ce sont aussi des matériaux de montage, qui facilitent le travail de construction.
Bien sûr c’est lié à l’économie mais pas uniquement.
Par exemple, le polycarbonate est un matériau très léger qui permet de faire de grandes surfaces transparentes, qui prennent le soleil et permettent la vue, avec beaucoup moins de structure que du verre.
Donc il y a l’économie mais il y a surtout ce que l’on attend d’un matériau, en quoi il répond aussi aux intentions du projet. L’économie du matériau ne veut absolument pas dire moindre qualité.
6-Quid des matériaux biosourcés.
D’une manière générale, nous nous sommes toujours attachés à employer le moins de matière possible dans la construction des projets. Nous cherchons toujours à faire des structures ouvertes de grande capacité pour réduire l’impact du matériau sur l’espace, ce qui sert aussi le projet d’espace plus grands. On a éliminé les murs qui contraignent définitivement l’espace et compromettent une évolution ou la reprogrammation dans le temps. Nous privilégions au maximum les solutions constructives de montage, qui permettent d’optimiser la matière employée et réduire l’effort de construction. Nous évitons le plus souvent les habillages rapportés et faisons-en sorte que ce qui constitue l’essentiel pour la construction, soit aussi ce qui est fini.
Aujourd’hui nous étudions aussi la solution de réaliser les structures en bois mais cela change la stratégie constructive, et aussi l’économie du projet. Il nous arrive de revenir à une structure béton et à de l’acier, mais la règle est toujours d’en utiliser le moins de quantité possible.
On cherche à minimiser l’impact des matériaux en poussant les études et les calculs pour qu’il n’y ait jamais de surplus.
Nous recherchons au maximum l’économie de quantité.
Les exigences actuelles d’utiliser des matériaux biosourcés ou issus du réemploi ne sont pas toujours adaptées à la réalité d’un projet, notamment quand on travaille sur un existant, et que l’on s’oblige à ne pas démolir et à utiliser sur site, ce qui est déjà là. On rencontre souvent un certain dogmatisme à vouloir tout ramener à des grilles de critères et d’évaluation, qui s’appliquent à des cas-types.
Tous les matériaux ont pour nous de l’intérêt, s’ils sont utilisés avec pertinence et économie. Les obligations quantitatives n’ont pas beaucoup de sens, si elles conduisent à utiliser plus de matériau que nécessaire.
Je pense que c’est très important d’avoir cette première démarche de parcimonie dans les matériaux employés, quels qu’ils soient et de ré-utiliser l’existant sur site au maximum. Si on utilisait mieux l’existant, sans démolition, on devrait avoir beaucoup moins de matériaux à ré-employer.
7-Qu’est-ce que l’architecture ?
Ce n’est pas une question facile. On peut passer sa vie à essayer de définir ce qu’est l’architecture.
Notre conception personnelle de l’architecture est de réaliser de l’espace pour la vie quotidienne, pour l’usage dans le sens qui touche au bien-être, au confort. L’architecture crée des relations et doit créer de bonnes relations en évitant les contraintes ou les restrictions. Nous nous intéressons aux espaces non fermés/non délimités/ouverts, avec l’idée d’une continuité permanente. Le dedans, le dehors, l’intime, le lointain, un sentiment de liberté, tout cela constitue la qualité d’un espace qui ne se définit pas par une entité délimitée par des matériaux.
Sur beaucoup de projets nous avons travaillé sur l’idée de l’échappement ; un lieu où à peine rentré on peut s’en échapper.
C’est pour nous une sorte d’obsession permanente dans la fabrication des projets : comment on s’échappe.
8-Quel est votre lieu préféré ?
J’aime bien en particulier les jardins. J’ai un beau souvenir des jardins du palais Topkapi à Istanbul. J’ai le souvenir d’un lieu magnifique, très simple, pas nécessairement ordonné, mais très poétique.
Parfois c’est quelque chose d’assez furtif quand on marche dans une ville, et qui reste.
De manière générale ce sont ces lieux qui échappent à la notion d’espace fermé. Des lieux qui créent la sensation que, après un espace, il y en a un autre, et un autre. Que ce n’est jamais fini.
9 -Quel conseil donneriez-vous aux jeunes architectes qui montent leur agence ?
Chacun se fait un peu comme il le veut avec son idéal, ses convictions, où il cherche à aller, ce qui l’intéresse. Je n’ai pas de conseils à donner. Je dirais simplement qu’il faut poursuivre idées et ses rêves.
Il y a aussi l’attention à porter aux autres, se rappeler que l’architecture est faite pour quelqu’un et non pour figurer. Cette conviction devient une occupation permanente, toujours nourrie par des projets, des sujets.
Je pense que c’est essentiel d’essayer de se construire sa propre approche, le sens qu’on veut donner à son travail. C’est compliqué, on passe par des hauts et des bas. Notre moteur a toujours été de se dire qu’il était important, à la fin d’un projet, d’être heureux de ce que l’on a fait, – ça n’exclut pas la critique- et d’avoir l’impression que l’on n’a pas perdu quelque chose en chemin.
Quand on est jeune il faut construire sa démarche, expérimenter et essayer de rester assez souple et libre pour précisément ne pas se contraindre dans des choses qu’on est obligé d’accepter car on n’a pas le choix. Malheureusement quand on est jeune architecte, il faut attendre trop longtemps l’opportunité de travailler et de faire des projets. Ce n’est pas normal.
10-Avez-vous senti des réticences par rapport au fait d’être une femme ?
J’ai sans doute eu de la chance mais je dois dire que je n’ai pas connu cette situation. Quelque fois des interlocuteurs se sont montrés surpris ou suspicieux, mais je n’ai pas eu à faire face à une situation de discrimination ou de non respect. Mes parents m’ont donné la confiance qu’être une femme ne devait jamais être un problème et n’ont jamais mis de réserve à ce que je souhaitais faire.
La situation des femmes en général dans beaucoup de milieux n’est pas bonne et ce qu’elle devrait être, le respect, l’égalité. Ce n’est pas acceptable.
En discutant avec mes étudiantes je vois bien qu’aujourd’hui cela semble plus compliqué qu’il y a 20 ans. C’est désolant, et c’est grave que rien n’avance.
11- Vous travaillez beaucoup sur la transformation en vous opposant à la démolition, pouvez-vous nous en dire plus?
Le sujet de la transformation est très important et depuis très longtemps et notamment depuis le début des années 2000 avec le démarrage des démolitions d’ensembles de logements modernes, dans le cadre de l’ANRU, nous sommes formellement opposés à la démolition et plaidé en faveur de la transformation. Parce que si l’on regarde attentivement il y a beaucoup de richesse et c’est une très mauvaise attitude de dire « on casse et on remplace ». Il y a la culture de conserver ce qui est ancien mais quand on arrive à une période plus récente ça ne marche plus.
Pour moi c’est absolument incontournable dans l’architecture et l’urbanisme, de partir de ce que l’on a déjà. La démarche est de considérer que l’on est dans des environnements construits, établis et qu’il faut partir de là et faire avec, apprendre à changer le regard d’analyse. Il ne faut jamais partir d’un présupposé négatif mais être curieux. Chercher toujours ce qu’il y a de beau et de positif dans l’existant.
Il y a eu depuis 20 ans un nombre très important de bâtiments et notamment de logements démolis, qui avaient encore une durée de vie possible, sans que cela suscite beaucoup de contestation ou d’opposition, sauf pour les gens qui y habitent et qui se battent avec beaucoup de force et d’engagement pour conserver leur habitation, sans être entendus. Ce sont des situations socialement très très dures.
Aujourd’hui la démolition est beaucoup plus critiquée, souvent pour des raisons écologiques ou de bilan carbone, mais il y en a encore beaucoup, et pas seulement en France. La démarche de réemploi qui se développe et devient presque une obligation dans les opérations, ne peut pas être une compensation. Au contraire, elle peut devenir un argument qui valide la démolition.
Un projet est aujourd’hui considéré plus vertueux dans le système des grilles de réemploi si l’on réemploie des matériaux ou des éléments provenant d’un lieu démoli ou déconstruit plutôt que de le conserver lui-même. Nous nous confrontons régulièrement à ces questions-là. Le plus performant est de transformer un site avec ses éléments, ré-employer sur site, sans démolir, plutôt que démonter pour réemployer ailleurs.
Il faut regarder ce que l’on a avec beaucoup d’attention parce que les lieux, les bâtiments, c’est aussi des gens qui les habitent. Cela concerne forcément les architectes.
12-Est-ce qu’il n’y a pas une limite à la démolition dans le cas de bâtiments complètement insalubres ?
Les bâtiments insalubres sont un cas très très particulier et minoritaire, ça n’a rien à voir avec les démolitions massives qui sont opérées. La plupart des bâtiments démolis ne sont pas insalubres et ont encore une durée de vie. Il ne faut donc pas se poser la question comme ça.
Il n’y a pas a priori de raison de remplacer. Il faut regarder chaque cas existant avec une approche réaliste et économe et surtout positive, qui part des valeurs existantes pour le faire évoluer. Transformer appelle aussi des solutions inventives.
Les calculs sont souvent faussés. Par exemple un éco quartier qui va s’implanter sur la démolition d’un ensemble de logements peut être jugé très vertueux mais parce que le bilan CO2 ne comprend pas l’antériorité, la démolition, le relogement, le déplacement des habitants.
13- Dans votre agence vous êtes nombreux ?
Non, nous n’avons jamais été très nombreux, peut-être 18-20 au maximum. Cela a été un choix de rester dans une taille où nous pouvions nous investir dans la conception tous les projets. Il y a un seuil d’équipe et de nombre de projets à partir desquels on ne peut plus suivre tous les projets. Donc on est toujours restés dans une petite échelle qui nous permet quand même de faire des projets de différentes tailles. De faire les projets les uns après les autres et de ne pas avoir à faire ce que l’on ne souhaite pas
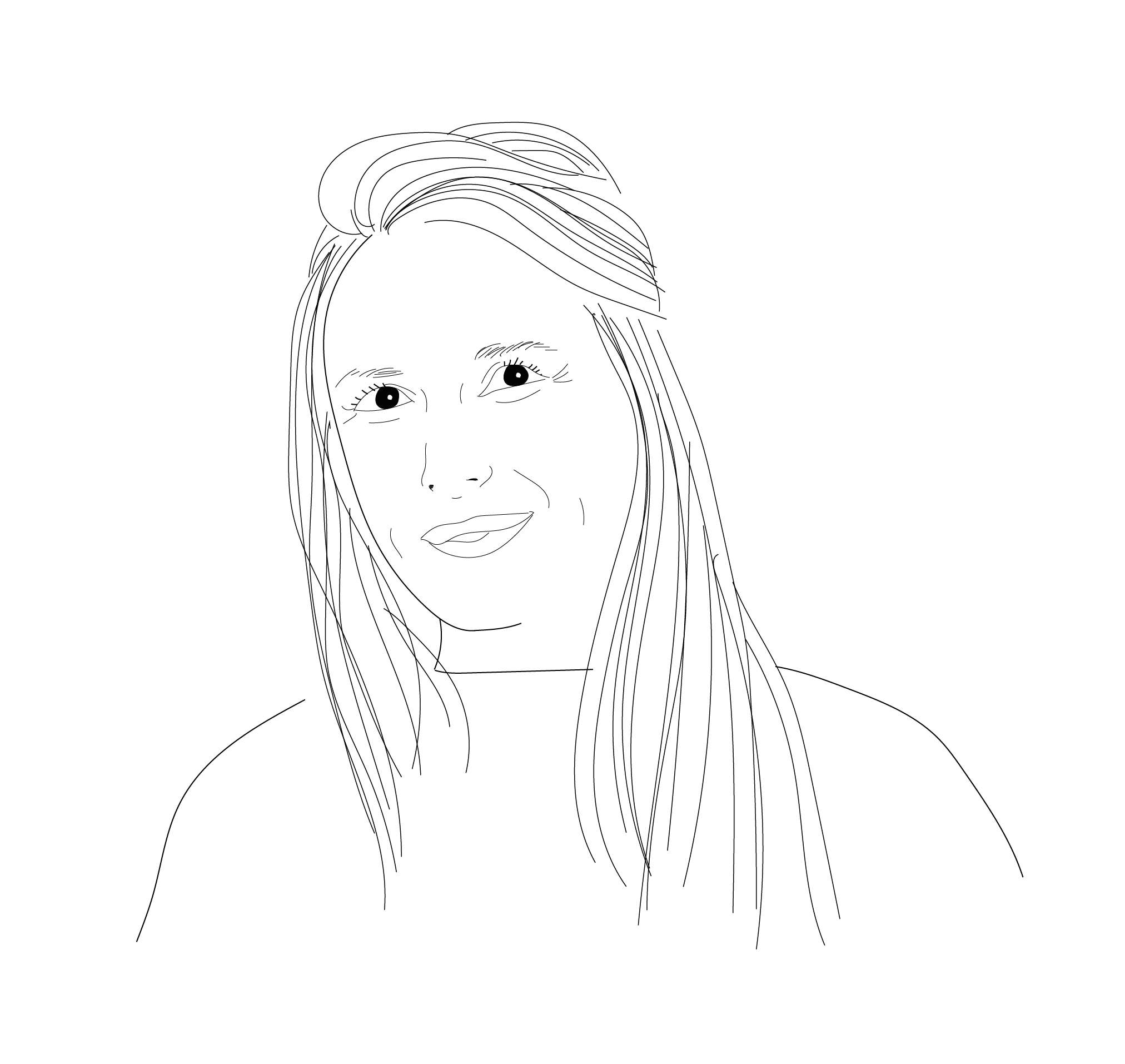
"Il faut se débrouiller pour proposer à des maîtres d’ouvrage des commandes qui n’existent pas"
Valentine Guichardaz-Versini est architecte et fondatrice de l’Atelier RITA qu'elle a créée en 2016 . Son agence a depuis remporté de nombreux prix l'Equerre d’Argent de la première œuvre en 2017 pour les Centre d'Hébergement d'Urgence d'Ivry-Sur-Seine. Elle est lauréate en 2018 des AJAP.
D’où vient le nom atelier Rita :
Ce nom vient de sainte Rita, c’est la sainte patronne de l’impossible et des causes désespérées. Je suis marseillaise et corse. En Méditerranée c’est une sainte qui est beaucoup priée. Je ne suis pas un brin catholique mais ma grand-mère, qui a une espèce de foi cachée, aime bien sainte Rita. Elle va souvent y poser des cierges et donc ça m’amusait de faire un clin d’œil à la fois sur la Méditerranée, sur les attributions de sainte Rita et pour rendre hommage à ma grand-mère.
« Sainte patronne de l’impossible et des causes désespérées » C’est un hasard par rapport à ton premier projet ?
L’agence a été créée à peu près au moment du début du chantier du Centre d’Hébergement d’Urgence. Mais c’est une coïncidence, j’avais déjà ce nom en tête deux ans avant de créer mon agence.
Tu as commencé en tant qu’autoentrepreneur ?
J’ai été diplômée en 2008. J’ai fait quatre ans de salariat. Au bout de quatre ans, je n’y trouvais plus mon épanouissement. J’ai eu envie de tenter des choses mais je ne savais pas quoi. J’ai commencé en autoentrepreneur en 2012 à Marseille, je n’avais pas d’ambition de monter une agence. Au bout de six mois – un an, j’ai pu vivre de ce que j’avais. C’était des petites choses mais ça m’a permis de me faire les dents. Un petit bout de réhabilitation d’une école privée, des appartements, des choses que l’on fait tous quand on démarre mais qui me plaisaient car c’était des échelles petites et maîtrisables qui m’ont permis de me mettre en confiance par rapport à ma pratique.
Et puis en 2013 je suis venue à Paris. Je ne trouvais plus vraiment mon compte à Marseille. Cela faisait 10 ans que j’y habitais. J’avais envie de m’ouvrir sur autre chose.
Comment s’est passée ta première année à Paris ?
La première année n’était pas évidente. Je ne connaissais absolument personne à Paris. J’ai fait des petits travaux dans une agence pendant quelque temps puis je n’ai pas travaillé pendant un an. Il fallait quand même gagner trois sous alors j’ai fait une peinture murale dans un hall d’immeuble. A la suite de ça, j’ai commencé à tirer un fil, puis deux, à des gens qui m’ont fait confiance.
Jusqu’au projet du Centre d’Hébergement d’Urgence à Ivry. C’est à ce moment que j’ai commencé à trouver quelle pouvait être ma mission en tant qu’architecte.
Comment as-tu accédé à la commande du Centre d’Hébergement d’Urgence d’Ivry ?
Ça m’est tombé dessus par hasard.
En 2016, je passais souvent devant le métro Stalingrad. Il y avait de plus en plus de personnes qui dormaient sous la passerelle. J’avais envie d’aider. Un jour, j’ai rencontré quelqu’un qui travaillait pour l’entreprise générale de construction Brézillon et qui avait monté un partenariat avec Emmaüs Solidarité. Il me dit « tu sais, tu es architecte, peut-être que ça pourrait les aider » et quinze jours après je suis allée avec lui au salon Emmaüs me présenter et tout de suite ça a collé. Ils m’ont appelée au début pour des petits projets comme une transformation de bureau en salle de lange, c’était minimal mais je trouvais ça intéressant de pouvoir aider comme ça.
Un jour j’ai reçu un mail disant « Est-ce que tu peux réfléchir à ce qu’on peut faire avec ça ? C’est pour 400 personnes, fais une étude de faisabilité et on voit », et c’est parti comme ça. J’ai donc commencé à dessiner avec du préfabriqué. Il n’y avait pas de concurrence parce que c’était plutôt des gens dans l’événementiel qui se positionnent sur ce genre de sujet, j’étais la seule architecte. Ce que je commençais à développer a tout de suite plu à Emmaüs. J’ai contacté mon ami de l’entreprise Brézillon pour lui demander si de son côté c’était possible de faire un chiffrage et de proposer ensemble un projet clef en main.
C’était super parce que nos partenaires d’Emmaüs nous ont fait confiance tout le temps, ils se moquaient complètement de mon chiffre d’affaires ou du fait que je n’avais pas d’expérience dans ce domaine-là.
C’était une sacrée aventure !
Et le chantier s’est bien passé ?
Oui le chantier s’est super bien passé. On a fait une conception-réalisation, ce qui d’habitude est un peu compliqué pour les architectes, mais qui là, était très adaptée. L’entreprise, très tôt, a pris part au projet, c’était efficace et on était dans la même équipe, on cherchait les solutions ensemble.
On était tous un peu dans le flou dans ce projet d’urgence. On s’est fait confiance et ça a fonctionné. L’équipe a été sélectionnée, je pense, à la fois par sa capacité à relever le défi de faire un chantier en quatre mois et à se dire « on va y arriver », et à la fois parce qu’ils étaient acquis à la cause et avaient envie de bien faire, dans les temps et avec générosité.
Combien de temps s’est écoulé entre le moment où on t’a proposé le projet et le moment où il a vu le jour ?
Il y eut deux mois d’étude et quatre mois de chantier. En six mois c’était fait, c’était très rapide. Nous avons livré une partie du projet en Janvier 2017, alors qu’on avait commencé le chantier en Novembre 2016. C’était très contraint comme temporalité.
Vous échangiez avec Julien Beller, l’architecte du CHU de la porte de la chapelle ?
Oui un petit peu. Nous nous sommes rencontrés à cette occasion. Mais nous n’avions pas de projet commun, ce n’était pas tout à fait les mêmes programmations, ni les mêmes temporalités d’hébergement, lui avait une convention d’occupation pour 18 mois alors que nous étions sur cinq ans. Les projets n’étaient pas pour les mêmes publics. Ses hébergements sont destinés à des hommes seuls alors que le CHU d’Ivry est destiné à des familles.
En revanche, sur le thème du projet, sur la complémentarité, sur le sens du projet, nous avons eu l’occasion de discuter, de faire des tables rondes.
Il y a deux typologies, une en yourte et l’autre en bois, quelles sont les différences ?
Je n’avais pas d’expérience dans ce type d’hébergements, je savais qu’il y serait logé des gens de la corne de l’Afrique, d’Afghanistan, de Syrie, des gens venant du bidonville Truillot d’Ivry qui a été démantelé ; des cultures très diverses allaient devoir se partager les lieux et je ne connaissais pas grand-chose à leurs différentes manières d’habiter. Il y avait donc deux solutions, la première d’étudier et d’affecter chaque culture d’habiter à une rue, mais ça aurait fait des rues pour les Erythréens, des rues pour les Afghans etc. et Emmaüs ne voulait pas de ça, ni même moi. La deuxième solution était de rendre les lieux les plus neutres et appropriables pour que chacun y vienne avec sa culture d’habiter sans que ce soit gênant pour les autres, ni une contrainte pour la personne qui y habite.
La structure d’un village est un invariant de l’habiter, tous les groupements humains fabriquent ces passages d’extraversion à introversion, de seuil progressif vers l’intimité.
On s’est dit que cette grande place sera une place centrale dans laquelle il y aura des éléments singuliers, comme des pavillons qui vont être des lieux de réfectoire, et qui vont marquer symboliquement, par leur forme, une différence avec le reste du centre d’hébergement. Sur cette place publique, on a aussi le pôle santé géré par le SAMU social, et un magasin de première nécessité, ce sont des installations de l’ordre de l’équipement sur cette place. Ensuite, il y a deux quartiers composés chacun de trois rues. Ces rues faites de modules bois sont larges de quatre mètres, pour instaurer un entre-deux entre l’espace de l’extraversion et l’espace de l’intime.
Il y avait deux batailles auxquelles je tenais et qui sont petites mais importantes, la première celle de conserver ces quatre mètres, pour accueillir le flux des gens qui montent et qui descendent, mais aussi accueillir de l’usage quel qu’il soit, qu’il ne soit pas tout à fait celui de l’espace public mais qui ne soit pas encore de l’espace privé. La deuxième était de pouvoir mettre de vraies portes palières pour rentrer chez soi, avec un petit tapis d’entrée, un espace pour déposer ses chaussures etc.
Et ça fonctionne plutôt bien comme ça !
Tu es allée rencontrer les habitants ?
Oui, j’y vais régulièrement. Il y a quand même la difficulté de la langue, on parle en anglais mais parfois c’est un peu compliqué. On a fait des interviews avec une quinzaine de personnes, j’ai des retours réguliers d’Emmaüs, de ceux qui travaillent sur place. Dans l’ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a un gros encadrement de la part d’Emmaüs ; 80 personnes y travaillent, donc ça aide. Les gens sont tous mélangés, il y a juste un côté famille et un côté plutôt pour les couples et les femmes seules.
Après, dans la programmation, le temps d’hébergement était de deux à cinq mois maximum, et le turnover était d’un mois et demi. Quand c’est réellement pour un mois et demi ça ne pose pas de problème, ça leur fait un moment de respiration et de repos dans leur parcours. Mais quand certains restent plus longtemps pour diverses raisons, ça devient compliqué car il n’y a pas de douche dans les modules, ce sont des douches communes, il faut prendre son repas dans les yourtes etc.
On a vu que tu as eu les AJAP en 2018, est ce que ça a été un accélérateur ?
On a eu un doublé entre l’Equerre d’argent de la première œuvre en 2017 et les AJAP en 2018. Je pense que ce qui a joué c’est la portée politique du projet, un projet atypique.
Mais oui, ça a été un boost, de passer de faire des fresques dans des halls d’immeuble à ça, on se sent un peu plus en visibilité et ça donne plus de légitimité à titre personnel. Ça m’a mise en confiance par rapport à ma capacité de faire de l’architecture, de faire correctement les choses, ça m’a rassurée. Et quand on est plus assuré, on arrive plus facilement à aller rencontrer des gens, pour dire « je suis architecte et je cherche du boulot ». En fait, ça a été plus un boost pour moi-même. Mais ça rassure aussi les maîtres d’ouvrage, vu qu’on est jeune, avec un chiffre d’affaires un peu bidon, ça les aide à nous faire confiance.
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes architectes ?
Aux élèves de PFE, j’ai tendance à dire qu’il faut qu’ils inventent quelque chose parce que la situation dans laquelle on est, est difficile. La situation financière des architectes est liée à une espèce de paupérisation parce que l’on arrive moins à trouver notre place dans les missions qui nous sont confiées. Il n’y a pas de reconnaissance de l’architecte.
Nous sommes arrivés à un point de rupture sur la manière dont nous travaillions jusqu’à présent. On ne va pas pouvoir reproduire le schéma de la génération précédente car il ne fonctionne plus. Il faut créer quelque chose, se débrouiller pour proposer à des maîtres d’ouvrage des commandes qui n’existent même pas. Il faut être là au bon endroit, au bon moment, ou volontairement aller chercher les projets ou les sujets de recherches qui peuvent eux aussi mener au projet. Tu vas fabriquer quelque chose.
Typiquement, pour le projet à Ivry, c’était des démarches qui n’existaient pas. S’il n’y avait pas un archi qui traînait là par hasard, ils n’auraient probablement pas pensé à faire ce CHU avec un architecte.
La question de la créativité de l’architecte en tant que créateur tout court se pose. Il faut dire « on va fabriquer notre commande, on va fabriquer notre métier ». Je pense que la génération qui arrive, et la nôtre qui commence à essayer de faire des choses, ont ça à faire.
Qu’est-ce que l’architecture pour toi ?
J’aborderais la question en faisant la différence entre l’architecture et être architecte.
Ma manière d’être architecte c’est de dire que l’on a une mission sociale, que l’on a un rôle à jouer de poil à gratter, d’emmerdeur, pour arriver à fabriquer le cadre de la ville d’aujourd’hui et de demain, le cadre de l’habiter qui va être en adéquation avec l’évolution de la société, les besoins des gens, l’usage et avec quelque chose qui serait aussi de l’ordre du dépassement, du laisser-faire, de voir comment les choses s’installent. C’est le cœur de la mission et c’est une vraie bataille.
L’architecture est immuable, c’est la discipline, c’est passionnant et c’est génial. Quand tu enseignes en licence c’est super, les étudiants découvrent tout et c’est merveilleux l’architecture. Après on devient architecte et c’est un peu plus douloureux parfois. Mais la passion est toujours là.
Justement que penses-tu du débat sur les charrettes qui font l’actualité en ce moment ?
Le débat est légitime. Les gamins qui ont vingt ans se posent des questions légèrement différentes de celles qu’on se posait nous. Nous on était un peu « il faut tabasser donc on tabasse ». Il ne faut pas dormir, on s’éclate la santé et ce n’est pas grave. Et eux se posent des questions de bien vivre, de bien être, et je trouve ça plutôt sain contrairement à certains collègues qui disent « ouais ils ne veulent plus bosser ». Je pense qu’ils se posent la question de comment bien vivre sans être l’esclave de quelque chose et ça vaut pour l’architecture mais aussi de manière générale comment ne pas être l’esclave de sa propre vie. Je trouve cette réflexion saine. Je le vois comme quelque chose de positif qui serait de l’ordre d’inventer un monde plus bienveillant pour chacun.
La culture de la charrette, je l’ai vécu. C’est-à-dire, tu en es ou tu n’en es pas.
Soit tu charrettes et tu en es, soit tu ne charrettes pas et tu n’en es pas. Personnellement, je n’en étais pas mais j’avais suffisamment de caractère pour dire je n’en suis pas mais je vous emmerde. Mais à cet âge beaucoup sont fragiles il y en a qui se disent que pour faire partie de ce groupe de reconnaissance et entrer dans la culture commune de l’architecture il va falloir passer par là. Donc ils s’abiment sévèrement la santé. Et cette culture perdure dans certaines agences.
Quel est ton lieu préféré ?
J’en ai plusieurs. Mon village en Corse qui s’appelle Partinello, un tout petit village perdu en Corse et je l’aime parce qu’il est perdu. Un de mes endroits préférés est sa plage toujours déserte. Elle n’a pas d’attrait particulier et du coup elle est à nous. D’une certaine manière, c’est là que je sens quelque chose en moi se réaxer. Tu regardes l’horizon, tu es dans ton sol et il y a quelque chose de biologique qui se passe.
Un autre endroit que j’affectionne particulièrement c’est l’Eglise d’urgence de Spitak en Arménie. Je l’ai découverte en faisant le tour de l’Arménie avec une amie arménienne. C’est une église qui a été construite en urgence dans le cimetière de Spitak qui était l’épicentre du tremblement de terre en 1988. Tout s’était effondré dans ce village. C’est un village perdu au milieu de rien. Il est très beau et surplombe un paysage de plaine immense désertique et lunaire.
On trouve d’un côté ce cimetière plein à craquer de personnes décédées à ce moment-là, donc déjà c’est fort. Puis il y a cette église faite en tôle sur le modèle de l’église apostolique en miniature comme une petite chapelle. C’est sublime. Je pense que c’est un de mes endroits préférés parce que ça m’a montré un certain nombre de choses sur la capacité de l’humain à fabriquer lui-même les conditions du symbolique. A la fois avoir du génie, à la fois avoir la manière de fabriquer avec ce qu’il a sur place à un moment M et de dépasser la simple question de se dire « on ne fait pas une boite à la con parce que c’est urgent, non il faut du beau. » Et ça, je crois que ça parle profondément de l’humanité.
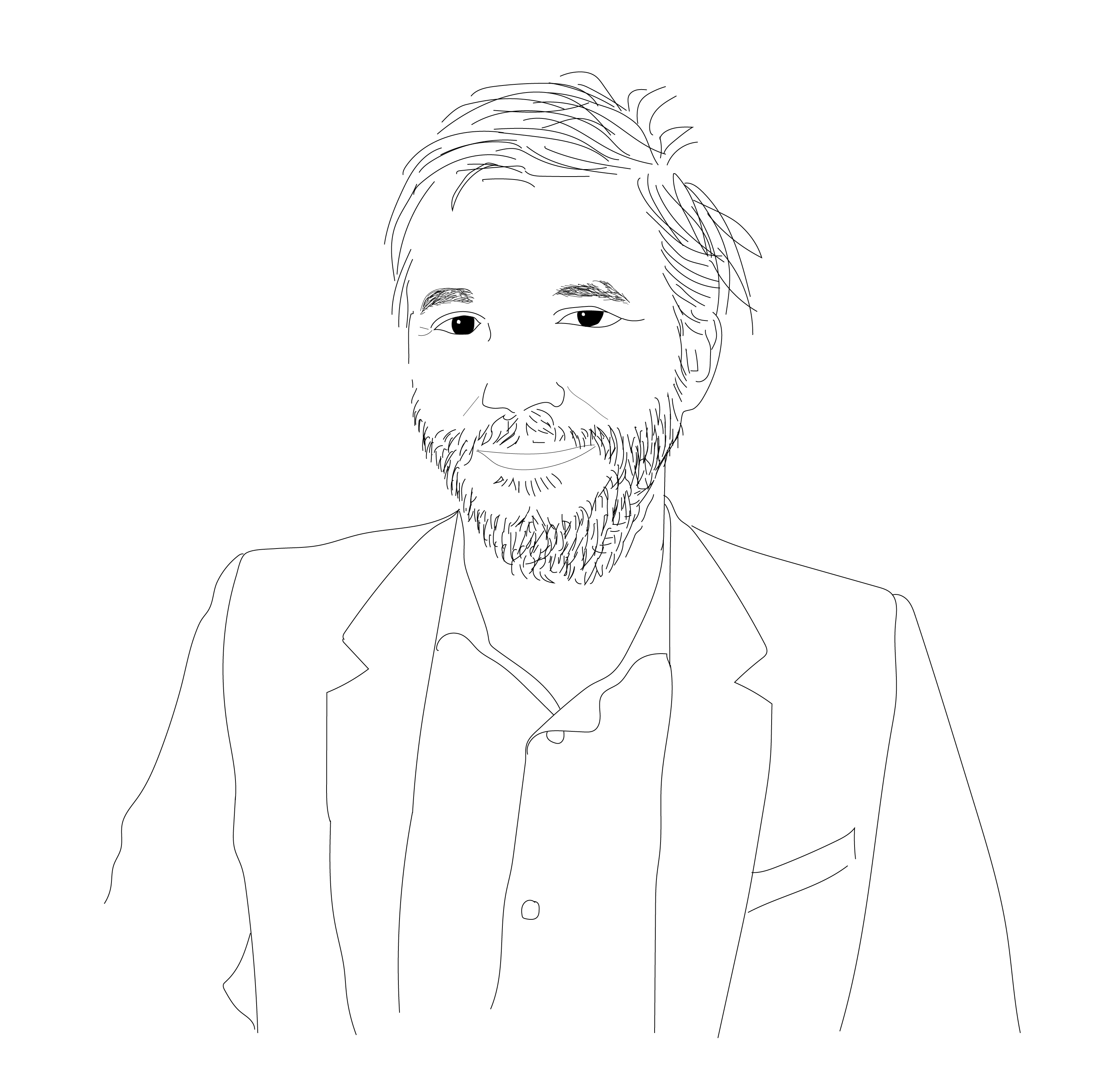
« Le privé est en train de prendre la main et de créer une nouvelle architecture»
Fabrice Long est architecte associé chez NP2F, agence qu’il a cofondé en 2009. Depuis, son agence a remporté de nombreux prix dont le prix Europan en 2008, l’AJAP en 2010 ou encore l’Equerre d’argent en 2016. Elle s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de l’architecture en France.
-Qu’est-ce que c’est l’architecture pour vous ?
L’architecture, c’est d’abord et avant tout une question d’usage. Notre rôle est d’organiser les usages et les fonctions dans un bâtiment, dans un lieu, une place. Cela a toujours été pour nous le seul but et le commencement de tout projet, avant la forme, l’objet ou l’esthétique : on s’attache d’abord à réfléchir à la fonction, à la taille des choses et à leur fonctionnement.
Pour autant, je crois que l’architecture est une question de gout avant tout. C’est un peu provoc, on peut facilement assimiler ça à du façadisme ou à de l’esthétisme superficielles mais il me semble que si l’architecte n’a pas de gout, il aura beau être super fort dans le côté fonctionnel, opérationnel ou technique, si son bâtiment est laid il sera laid et inversement un bâtiment qui n’est pas forcement incroyable en termes de puissance et de concept s’il est dessiné avec goût pourra avoir une certaine forme de réussite.
Le graal étant quand la fonction est puissante et l’esthétique l’est aussi. En tout cas je pense qu’il y a toujours une affaire de goût.
Si on va dans ce sens, alors le choix de la structure, de l’espace et de la fonction est lui aussi piloté par le goût. Ce n’est pas que la couleur de l’enduit, la couleur du carrelage qui vient en bout de course, mais tous les choix que l’on fait successivement.
L’architecture c’est d’avoir le souhait d’organiser la beauté à tout moment de la conception. Ce n’est pas un entonnoir où l’on met des choses et hop on en ressort une belle image, c’est un écosystème au sein duquel chaque étape est cruciale pour arriver à construire un beau bâtiment.
Si on n’a pas la conscience de devoir être beau pour moi on échoue.
-Quel est votre lieu préféré ?
Il y en a plein. J’aime un lieu lorsque j’ai le sentiment de percevoir l’intention de l’architecte, de sentir ce qu’il a voulu exprimer. C’est ce que j’ai ressenti à Saint Pétersbourg par exemple. Le fleuve de la Neva qui traverse la ville est très large, il fait 5 ou 6 fois la Seine, et les bâtiments autour font tous la même hauteur, ils sont assez bas, ils n’ont pas plus de 3 étages pour la plupart. Leur façade est un rectangle parfait très fin et très long. Ainsi je me suis dit que c’était un souhait de la ville, de l’urbanisme de dessiner une sorte de velum. C’est impressionnant de maitriser à ce point-là un ouvrage aussi grand et qui impacte autant le profil de la ville.
-Quand et pourquoi avez-vous décidé de monter votre propre agence ?
On a monté notre agence l’été après le diplôme, on travaillait dans différentes agences, et en parallèle, on commençait à réfléchir à notre agence, on faisait aussi des petits appartements.
Nous sommes passé sur l’émission Capital sur M6 grâce à un de nos appartements. Il s’agissait d’une émission sur la crise, les petits logements, la baisse des surfaces et comment se débrouiller dans les petits espaces. Le Lundi suivant, on a reçu beaucoup de mails, et beaucoup d’appels. Suite à ça nous nous sommes lancés quasiment à plein temps. Les 5-6 première années, nous avons surtout faits des petits appartements. C’est essentiel mais ça prend du temps et les clients ne sont pas toujours faciles à gérer. Ils pensent souvent qu’ils sont ton seul client, te sollicite les week end, la nuit parfois pour être rassuré sur la mauvaise position de telle applique…
Et puis on avait envie de dessiner de belles choses, d’inventer. Pour nous c’était un peu compliqué de dessiner pour quelqu’un. On a ressenti le besoin de s’exprimer en notre nom.
-Comment vous répartissez vous les taches entre les 4 associés ? Et quand avez-vous mis cela en place ?
De manière générale, on conçoit tout le temps tous les 4. On s’est ensuite chacun de nous un peu spécifié, notamment par rapport à nos penchants, certains sont plus dans la prospection et d’autres plutôt dans la conduite des projets. on écrit un peu chaque jour notre cohabitation.
-Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus dur en commençant ?
Le plus dur c’est de comprendre ta marge de manœuvre. Qu’est-ce que tu peux faire avec le client, jusqu’où tu peux aller. L’impact que tu as.
Mais plus ça avance et plus on s’en rend compte que l’on peut avoir du poids, notamment avec les marchés publics où les clients sont complètement respectueux de ce que tu fais. Ils nous ont toujours dit : « on ne juge pas l’architecture, nous on arbitre les finances et les typologies d’appartements, on vous dit notre cahier des charges mais l’architecture vous la faite tout seul ». Nous sommes seuls maitres à bord. Le chantier IMVT par exemple, le projet n’a pas changé d’un iota depuis le concours. On se bat depuis 3 ans pour que ce que l’on a imaginé soit le bâtiment construit et le client qui est le ministère de la culture nous a toujours laissé faire. Donc l’architecte à un vrai poids une vraie force, mais c’est dur d’assumer cette force au début de sa carrière. On est timide, on n’ose pas. On est beaucoup soumis au clients, à leur souhait à leurs demandes plus ou moins raisonnables.
Plus tu avances plus tu as des gros clients, plus ils savent ce qu’ils veulent à ta place et plus c’est une bataille. Peut-être que si tu es Chiperfield ou Rem koolhas tu peux commencer à avoir un pouvoir de persuasion plus fort.
Nous on a de plus en plus envie de dire que c’est nous qui décidons en tout cas, et de dire que l’on peut ne plus tout accepter aussi par militantisme parce que c’est notre devoir de défendre l’architecture et le fait que l’architecte puisse jouer un rôle fort dans la conception des bâtiments.
-Avez-vous eu le sentiment de manquer d’expérience sur les premiers chantiers ?
Oui souvent, mais cela ne nous a pas empêché d’agir pour autant. En fait c’est assez facile un bâtiment, cela reste basique, on est pas en train d’opérer un patient à cœur ouvert comme un chirurgien. Et puis on est aidé, plus le projet est gros et plus les BET sont un soutien technique fort.
Finalement c’est plus de stress que de difficultés.
-Comment êtes-vous parvenu à accéder à la commande publique ?
Premier concours public avec Poitevin, le CNAC l’école du cirque à Châlons-en-Champagne.
Je dirais que c’est un ensemble de choses. On a commencé par les petits appartements puis des petits concours comme Europan, les AJAP. On n’a jamais su dire s’il y avait eu des retours par rapport à ça, si ça nous avait directement ramené des marchés ou non mais c’est important de gagner ce genre de concours, c’est galvanisant. Et puis ça cristallise ta position, puis tu fais des projets de plus en plus gros, une étude pour un promoteur privé et ainsi de suite.
Le premier concours que nous avons réussi était le CNAC, pour l’école du Cirque de Châlons-en-Champagne pour lequel nous nous sommes associés à Mathieu Poitevin. Les collaborations c’est important au début de sa carrière d’architecte.
-Qu’est-ce qui vous inquiète le plus en tant qu’architecte ?
Ce qui m’inquiète c’est de constater que l’état a de moins en moins d’argent et mène de moins en moins de projets, ce qui laisse toute la place au privé. Or à mon sens aujourd’hui le secteur privé n’est pas assez vertueux pour que l’architecture continue à exister telle qu’on l’imagine. Le premier intérêt d’une boîte privée est le profit, ce qui ne permet pas à l’architecture de s’épanouir de manière saine ou intéressante à mon sens.
Nous la vision que l’on a de l’architecture, si je la vulgarise, est plutôt une architecture industrielle, d’ossature avec de très grande baies. C’est plutôt une structure qu’un bâtiment. Forcement c’est très cher par ce que ce sont des grandes hauteurs, des grandes baies des grandes vitres, c’est peu de murs. Le promoteur, lui, il veut des murs très épais, des petites fenêtres, des petites hauteurs sous plafonds et du coup c’est compliqué de faire de l’architecture avec les pires règles que l’on t’impose.
-Comment voyez-vous l’évolution de la profession ?
Je ne sais pas, je ne suis pas assez visionnaire pour le savoir. Le privé est en train de prendre la main et de créer une nouvelle architecture. On peut tout imaginer. Est-ce que demain il y aura des promoteurs architectes ? Des auto-constructions de gens qui s’assemblent et qui financent un projet qui sera du coup très libre et très beau ? Est-ce qu’il y aura des promoteurs éclairés qui vont vouloir être écologistes, moins marger et faire des beaux bâtiments ? Tout ça pour dire que je ne sais pas ce qui arrivera mais j’espère que l’architecture continuera à exister de mille manières car c’est l’affaire de tous, les gens y sont sensibles.
-Comment vous est venu la mise en place du style graphique qui vous caractérise ?
On fait beaucoup des collages, car à tout moment du dessin on a besoin d’éprouver ce que l’on dit. Notre réflexion part d’une image, d’un collage rapide. Si on cherche des structures il nous arrive on de faire jusqu’à 5 esquisses de différentes structures. Pareil si l’on parle de la taille de chose, d’empilement de plusieurs programmes ; avant de décider on le construit en image et on voit si c’est harmonieux par rapport au quartier, au bâtiment qui est en face, à la place qui est en bas etc.
-Vous construisez beaucoup en béton, est ce que on vous le reproche pas de plus en plus ?
Il y a un réel problème de coût. Peu de décideurs et de financeurs de l’architecture et de la ville n’ont les moyens financiers pour mener à bien des projets 100 % bois. Il y a après beaucoup d’autres moyens d’être vertueux, sur la consommation du bâtiment, sur des matériaux plus locaux.
Par exemple pour notre projet d’Arena, il y a une réelle économie du volume bâti, réduit à son strict nécessaire, sans vide de construction.
-Quel conseil donneriez-vous aux jeunes architectes qui montent leur agence ?
Essayez d’avoir une ligne, soyez radical. Il faut écouter le client mais il faut savoir le brusquer un peu parfois.
« La philosophie de conservation renforce les convictions et les démarches écologiques »
Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques depuis 1990, Inspecteur Général des Monuments Historiques depuis 2003 et membre de l’Institut depuis l’automne 2019. Responsable de la Villa Médicis et des édifices français de Rome, du théâtre lyrique de l’Opéra Comique – Salle Favart (Paris IIe), du Domaine de Chantilly.
C’est quoi pour vous l’architecture ?
L’Architecture est l’espace de l’épanouissement de l’homme. Cette dimension apparaît encore plus clairement maintenant que nous sommes en temps de confinement. L’architecture est faite pour l’homme, et doit pouvoir offrir toutes les dimensions de l’habiter.
J’ai la conviction que l’architecture doit être un engagement et sans doute la recherche d’un absolu. Paul Valéry dans Eupalinos ou l’Architecte* établissait en 1923 une relation entre l’Architecture et la musique; la vraie architecture serait celle qui mobilise nos sens. La grande architecture est pour lui une expérience musicale.
Quel est votre endroit préféré ? Pourquoi ?
Tous les endroits où j’ai travaillé ont compté pour moi. Je suis toujours saisi par la richesse et la diversité des lieux.
Un endroit compte beaucoup pour moi c’est l’Atelier de Donald Judd à New York, dans l’ancien quartier industriel de Soho qui était à l’abandon dans les années 60. Toute une génération d’artistes se saisit de ce quartier d’architecture en fonte qui illustre la diffusion de l’architecture industrielle. Donald Judd s’installe dans un de ces bâtiments entrepôts. C’est le lieu où il va vivre et où il va créer et exposer sa pratique la plus radicale des arts plastiques. Il utilise des boîtes, en plusieurs matériaux, plutôt en métal, en contreplaqué et simultanément il engage une restauration extrêmement respectueuse de son bâtiment.
On peut être le créateur le plus radical, bouleverser l’histoire de l’art, renouveler la tradition tout en considérant que cette création s’incarne dans un lieu qui doit être traité avec le plus grand esprit de conservation. C’est cette dualité que je trouve très belle.
—
Quel a été le bâtiment sur lequel vous avez travaillé à vos débuts qui vous a le plus marqué ? Pourquoi ?
Ma première expérience de jeune architecte en agence m’a passionné. J’ai dû faire le relevé de la charpente de l’Église de Sizun, une charpente à berceaux lambrissés du XVème-XVIème siècle. J’ai découvert un matériau, une technique, des hommes de l’art les charpentiers et j’ai découvert que la charpente est une structure, qu’elle définit un espace. J’étais en fait saisi par la poésie de ces lieux, le comble est un espace perdu, ignoré, coupé du monde. Le drame de Notre-Dame de Paris remet au coeur ce lieu, la relation complexe qui existe entre architecture, matériau et structure et valeurs symboliques.
Qu’est ce qui vous a mené dans cette voie du patrimoine et de l’architecture ?
J’ai été attiré par l’engagement humaniste et sociétal que représentait l’architecture. Cette fascination que je ressens à regarder l’histoire de l’architecture, à essayer de comprendre ce qui est déjà là, ce qu’elle a à nous dire, occupe mon cœur et mon esprit.
Toute l’architecture et toute l’histoire doivent être regardées. J’étais convaincu que les monuments historiques doivent être en renouvellement permanent et qu’il faut regarder le monde actuel. Cette conviction m’a amené à m’engager pour les architectures les plus récentes qui ont le plus de difficulté à avoir une reconnaissance patrimoniale. Je suis impliqué de façon militante dans la défense de l’architecture du 20ème siècle.
Est-ce plus difficile de défendre des bâtiments modernes ?
Pour les œuvres du 20ème siècle, il n’y a pas eu ce travail d’oubli, de réinvention, de recherche architecturale et elles sont plus difficiles à comprendre, à appréhender et à juger. C’est pour cela qu’elles doivent être défendues. Le mouvement Moderne aujourd’hui est accepté mais la production de la fin du 20ème, par exemple le Postmodernisme, est en train de disparaître en totalité.
Comment collectez-vous les informations, en quoi consiste votre travail en amont, pour structurer les interventions ?
J’ai acquis la conviction que, l’architecture est complexité. On doit répondre par un travail de recherche qui permettra d’identifier cette complexité qui compose les éléments d’architecture. Avant d’émettre mon avis, j’essaie qu’il soit fondé le plus scientifiquement possible sur une recherche documentaire, archivistique, pluridisciplinaire et ce n’est que à partir de là que je construis ma compréhension de cet édifice.
Le plus souvent je découvre, même si c’est une architecture récente, qu’elle a déjà eu une vie et des transformations. J’essaie de comprendre aussi ce qu’est l’édifice aujourd’hui par rapport au moment de sa création, quelles sont les transformations qu’il a subies, je l’accepte comme une structure plus complexe.
A quel moment l’architecte des MH peut se permettre une interprétation, une subjectivité ?
On peut répondre que toute intervention sur un Monument Historique est un projet comme toute démarche architecturale. A partir de là, la personnalité de l’architecte et de son agence est engagée. Le Monument Historique a son identité propre et le projet doit respecter qu’il est un bien collectif, partagé. La démarche de restauration ne devrait pas être une volonté de se singulariser, c’est une démarche faite au profit de l’édifice.
Comment abordez-vous cette question de la responsabilité ?
La responsabilité, vis à vis du monument et de l’édifice, c’est cette étude approfondie qui permet d’en révéler toute la complexité. Ma responsabilité, c’est d’aller au fond des choses et d’avoir une analyse très profonde de cette architecture qui m’est confiée.
Mes interventions doivent être transparentes, lisibles, justifiées et documentées. Tout le monde doit pouvoir savoir ce qui a été fait. Mon engagement est de transmettre ces monuments, de les faire perdurer.
Selon vous quand la logique de conservation se justifie -t-elle ? tout le temps ?
Tout le temps ! Je pense que la logique de conservation est un enjeu philosophique.
Bruno Zevi nous dit de regarder toute l’histoire. Nous avons la chance en tant qu’architecte d’être confronté à l’un de ces jalons de l’histoire, à nous de pouvoir le transmettre pour que quelqu’un comme Bruno Zevi puisse le réécrire dans 50 ans. Pour cela, il doit être conservé, considéré comme une matière archéologique fragile qui doit être stabilisée et transmise. C’est une manière de passer de l’architecture au laboratoire ou à l’archéologie.
Au bout de combien de temps un Monument est considéré comme MH ?
Jusqu’à André Malraux, qui a totalement renouvelé notre regard, il n’était pas possible de protéger un édifice du 20ème siècle parce que il était écrit dans les textes que l’édifice devait avoir une valeur archéologique. Or il était difficile que la villa Savoye ou que l’unité d’habitations de Marseille de 1952 soient reconnus en 1965 comme une valeur archéologique. On a eu l’intuition qu’en supprimant ce paramètre il ouvrait le MH au 20è siècle. Il y aura toujours cette hésitation et cette interrogation sur le besoin de recul pour analyser une architecture. Aujourd’hui les architectures les plus récentes peuvent être protégées.
Qu’est ce qui participe à la longévité et à la force d’adaptabilité d’un bâtiment ?
Pour la durabilité d’un bâtiment, on va parler de sa qualité constructive, sa capacité à être entretenu, la question de la maintenance qui est sans doute liée à la question de l’usage.
Pour qu’un édifice perdure, il faut qu’il soit utilisé, mais l’utilisation peut être la remise en cause son usage historique. La Villa Médicis, qui était le palais des Médicis est devenue une résidence pour artistes. Tout édifice est transformable, la question est de savoir si cette transformation se fait au détriment des valeurs de cette architecture ou au contraire l’enrichit.
Sur quels bâtiments avez vous travaillé où il y a eu le plus de mutation d’usages au fil du temps ?
Un édifice récent ne va pas être très modifié alors qu’une grange cistercienne a pu avoir vingt vies différentes. On peut partir d’un édifice où l’évolution d’usage est le plus limité possible, comme la maison Laroche, construite par Le Corbusier, qui s’est cristallisée, muséifiée.
Sur la Bourse de Commerce- Collection Pinault, sur laquelle je travaille en ce moment pour la partie conservation et dont la création est conduite par Tadao Ando et l’agence Nem, les changements ont été importants. Cette ancienne halle aux blés a été transformée en 1889 par Blondel pour la Bourse du Commerce de Paris. Cet usage, maintenu jusqu’à une période récente va basculer dans un renouvellement culturel. Il s’agit d’un changement d’affectation radical pour introduire l’art le plus contemporain au cœur de Paris. C’est un renouvellement architectural, urbain et patrimonial avec pour enjeu d’écrire cette nouvelle fonction sociale et de la mettre en dialogue avec l’histoire. C’est un projet de création et de conservation.
Avez-vous senti une évolution de la pratique ?
Oui, c’est une pratique radicale. Tout d’abord, le patrimoine est devenu un sujet partagé. La Journée du Patrimoine et les émissions dédiées introduisent dans le débat actuel une pratique démocratique.
Deuxièmement, il y a eu l’évolution du monde savant qui a fait comprendre que la matérialité était une dimension essentielle du patrimoine. Aujourd’hui il s’agit de conserver et non pas de reconstruire les monuments.
Troisièmement, nous faisons des métiers ou la pluridisciplinarité ne cesse d’augmenter. La complexité des projets nous impose de travailler avec des spécialistes et nous devons assumer notre responsabilité.
L’intérêt pour le patrimoine construit semble aujourd’hui se lier inévitablement à la préoccupation écologique, dans une logique d’économie de matière, de valorisation du “déjà-là”, d’incitation à la modération, la sobriété et la modestie des interventions qui semblent les mots forts de la création architecturale de ce nouveau millénaire.
C’est très juste.
Le patrimoine doit affirmer ses valeurs en termes de développement durable. Il privilégie le “déjà-là”. La philosophie de conservation renforce cette conviction et les démarches les plus récentes engagées dans le remploi des matériaux déposés ou issus de démolitions constituent pour moi des démarches patrimoniales.
Même dans le choix des entreprises et de la main d’œuvre. Il s’agit de transmission des savoir faire ancestraux et locaux et d’entreprises française. C’est aussi en ça que c’est une pratique plus “écologique”.
Tout à fait, le chantier est le lieu qui n’existe que par les compagnons et les ouvriers qui apportent leurs compétences, on a besoin de l’œil et de la main du charpentier et le chantier est le lieu qui permet au charpentier de maintenir son savoir faire et de le transmettre à des plus jeunes. Les savoirs-faire évoluent en permanence.
L’amiante et le plomb ?
Le plomb est systématique dans presque toutes les architectures. Il est utilisé dans les couvertures, les canalisations, les peintures au plomb. La pollution urbaine a entraîné des dépôts de plombs sur les façades ou même à l’intérieur des édifices. C’est un sujet propre à toutes les architectures déjà-là, pas seulement aux MH.
Dans l’architecture du 20ème, on a utilisé l’amiante dans les flocages, dans les joints, dans des colles de revêtement de sol et ces matériaux vont être trouvés dans les MH par exemple dans les menuiseries restaurées dans les années 70 avec des mastics amiantés.
Comment travaillez vous maintenant dans le contexte du confinement avec les chantiers ?
Les architectes de l’agence sont en télétravail, il y a aussi du chômage partiel. Une agence c’est un assemblage de temporalité avec des dossiers qui sont à l’étude et des chantiers. Tous les chantiers sont arrêtés. Tout le monde doit être traité avec la même considération que l’on soit architecte ou ouvrier.
Comme tout le monde j’ai dû apprendre le télétravail, les conférences téléphoniques et peut-être à en mesurer les limites. Je me rends compte que je ne peux pas me passer du studio qui doit être le lieu d’échanges entre les architectes, paysagistes, historiens.
Il est certain que nous devrons vivre sans doute différemment sans que l’on mesure exactement ce que cela signifie. Architecte c’est être dans la société, nous devons être ensemble et pas isolés des autres.
« L’architecture fonctionne de façon parallèle à la mise en scène »
Vincent Macaigne est un acteur, auteur, metteur en scène de théâtre, et réalisateur français. En 1999, il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. A côté de ses nombreux rôles au cinéma où il a été mis en scène notamment par Louis Garrel, Guillaume Brac, Olivier Nakache et Eric Toledano, il s’illustre dans les théâtres publics européens en tant qu’auteur et metteur en scène avec des pièces comme « Idiot ! » en 2014, ou « Je suis un pays » lui valent la reconnaissance du public et des critiques.
Il nous partage sa vision de l’architecture et de la mise en scène.
C’est quoi pour toi l’architecture ?
Essayer d’adapter l’espace aux hommes, à leurs besoins, à leurs goûts, de penser l’espace et le temps qu’on y passe, de penser le mouvement dans un espace et de l’organiser. C’est d’imaginer et de façonner un espace vers une façon de vivre. C’est pour cela que l’architecte varie avec les époques, je crois.
C’est quoi ton endroit préféré ?
J’adore les théâtres parce que tout peut y arriver. Vide il garde quelque chose des histoires et des aventures passées, il est chargé. Et c’est un espace souvent assez grand. Grand concrètement et dans l’imaginaire. Grand, dépouillé et prêt à accueillir.
—
En tant qu’auteur et metteur en scène, qu’est ce qui t’inspire pour concevoir un projet ?
Souvent l’espace, une idée d’un espace et d’un temps, une atmosphère, une sensation de ce qui pourrait arriver dans cet espace, l’espace est au centre. Je commence à imaginer l’accident qui pourrait arriver dans cet espace quand je l’ai visualisé et l’histoire arrive.
Est ce que d’une certaine façon tu te considères comme un architecte ?
Non, mais je pense que l’architecture fonctionne de façon parallèle à la mise en scène. C’est circulaire comme dans la mise en scène. On est obligé de commencer à travailler avec des idées qui sont parfois fausses mais qui servent à trouver la chose la plus juste. Il faut façonner sur des hypothèses et la réalité dicte la façon de modifier ses réponses à ces hypothèses.
C’est quoi, selon toi, une bonne mise en scène ?
Quelque chose qui arrive comme un accident. Qui saisit de façon émotionnelle. Qui peut déplaire ou plaire mais surtout qui se redéveloppe dans l’imaginaire avec le temps, deux jours après, une semaine après, un an après. L’impact et la mémoire. Ce sont mes deux pensées quand je travaille. L’organique et la mémoire. Le lieu, l’espace doit être traversé et bouger. Une bonne mise en scène, c’est une mise en scène qui transforme le monde, l’espace. La ville qui entoure le théâtre doit avoir changée de texture quand on ressort de la salle. Le moment a été un vrai moment infini et contenu. Une révolution
Quels sont les indices que tu vas collecter pour arriver au choix des décors ? de l’ambiance ? de la luminosité ?
Je travaille à partir des répétitions avec les comédiens. L’espace m’est inspiré par leurs gestes, leur voix, leur imaginaire. Après ces répétitions je me mets à chercher des peintures ou des photos, et dans un deuxième temps j’aime beaucoup collaborer et échanger sur ce que va être l’espace. Et quand cet espace est défini dans ma tête et j’aime passer par une maquette pour me projeter dans le spectacle et définir le projet d’une manière plus précise.
Créer une ambiance éphémère dans un théâtre pérenne. Prends-tu en compte le volume et l’architecture du théâtre dans lequel tu t’implantes ?
Oui évidemment, c’est le premier des défis, faire un décor qui colle à plusieurs théâtres de volumes différents et qui ait l’air réel à chaque fois et qui s’adapte à chaque théâtre. En France un spectacle se produit grâce aux tournées dans les théâtres partout dans le pays. Le spectacle doit être pensé de façon à être démonté et remonté. Enfin il y a aussi les spectacles qui s’inscrivent dans des décors réels, des lieux déjà existant, des églises, des cours, des hôpitaux, et c’est toujours sublime les spectacles hors les murs, où le vrai lieu devient le décor, où le spectacle se charge de la force d’un lieu véritable, ou le patrimoine architectural charge l’imaginaire et ajoute de la magie au spectacle.
Rencontres-tu des contraintes dans ta mise en scène liées à l’architecture ?
Oui bien sûr, souvent je suis amené à essayer de cacher les actes architecturaux dans les théâtres. Mon travail c’est de créer un univers propre à mes spectacles et parfois quand l’acte architectural est trop présent dans la salle de spectacle du théâtre, ça peut devenir un problème et je suis amené à cacher les murs des salles et ré architecturer l’espace pour plonger les spectateurs d’une manière plus fluide dans mon univers.
Quels conseils donnerais-tu aux architectes pour améliorer la conception des théâtres ?
Penser à la vie, à la mémoire, être humble, imaginer ce que c’est d’écouter un comédien, penser au son, penser à l’espace et à comment on regarde. Penser que le théâtre c’est une expérience pas une salle d’événementiel multitâche. C’est une salle, un endroit qui doit accueillir un millier d’histoire un millier d’accident au sens propre et au sens figuré. D accueillir en toute sécurité et avec le confort. Un endroit dangereux et en même temps complètement rassurant. Penser à la couleur noire. Parce que le noir disparaît.
Que serait ton théâtre idéal ?
Celui qu’on doit inventer, qu’on doit construire.
« Mon travail c'est de m'occuper des collemboles »
Raphaël Duroy, paysagiste et fondateur de Amare Horto depuis 2013. En latin, « Amare » signifie aimer et « Horto » jardin. Il conçoit aujourd’hui avec son équipe de nombreux jardins en apportant un soin particulier sur le respect du végétal.
C’est quoi pour toi l’architecture ?
Mon père était journaliste d’architecture. C’est un élément qui est toujours resté présent dans ma création et qui continue à l’être. Un jour, on marchait sur le canal de l’Ourcq en regardant les nouveaux immeubles près du MK2 et il m’a dit quelque chose comme “ en architecture rien ne peut être inutile”. Cette phrase m’est vraiment restée, je pense que dans toutes les formes d’art c’est extrêmement vrai. Pour moi l’architecture est une discipline où rien n’est inutile.
Je vois l’architecture derrière les arbres et non pas les arbres devant l’architecture. Ma grande image c’est Central Park où l’on voit les immeubles qui dépassent de la crête des arbres et là, d’un coup, j’entrevois l’architecture. Elle ne m’intéresse que lorsque le végétal est présent. Lorsque l’on voit des temples en Asie entièrement recouverts de ficus, que l’on est à Central Park où l’on a l’impression que les chênes sont trois fois plus grands que les buildings qui par ailleurs sont gigantesques ou même à la Villette, c’est très beau, on voit la crête des arbres et les immeubles derrière. Une architecture réussie me semble être une architecture qui s’adapte à la nature.
Quel est ton endroit préféré ?
Au niveau architectural, la vue de la ville à travers les arbres de Central Park et au niveau personnel, c’est mon atelier, l’espace où je peux être seul dans une pièce avec mon travail.
—
Qu’est ce qui t’a mené dans cette voie ?
C’est forcément une longue réponse mais le premier élément déclencheur a été d’être malade dans la vie que je menais avant. J’étais en désaccord avec le monde. Et je pense que quand on est perdu dans la vie, il faut revenir à ce que l’on se disait enfant.
Enfant, j’aimais la photo et les plantes. Mon goût pour la photo m’a mené dans le monde du cinéma. Je travaillais à la Fondation Cartier, je faisais des films d’expos, et comme ils se rendaient compte que je devenais ami avec le jardinier à force de m’intéresser au jardin, ils m’ont commandé un film sur les jardins de la Fondation Cartier.
Ma première réflexion c’était quand même qu’il fallait que je nourrisse ma femme et mon fils. C’est comme ça que j’ai commencé à passer des annonces pour tondre des pelouses.
Je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien et que c’était vraiment un très bon remède au mal dont je souffrais.
En fait, travailler avec le vivant, c’est un travail de gestation où tout commence quand nous avons fini. Et ça pour moi ça n’existe que dans le paysage, ça prend place, ça se crée par soi-même et cette connaissance m’a permis de me poser aussi beaucoup de questions sur l’état de notre planète.
Francis Hallé dit “Quel que soit votre métier, à un moment donné vous allez vous demander si vous n’êtes pas en train de perdre votre temps, et même si vous n’avez pas une activité pernicieuse. Vous pouvez être commerçant, archevêque, marin pêcheur, musicien ou médecin, tôt ou tard vous aurez l’impression de perdre votre temps. Il existe une seule exception : si vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que vous faites est bien” (cf. La vie des arbres)
Comment conçois-tu le jardin ?
Mon travail c’est de m’occuper des collemboles. C’est la faune extrêmement importante qui habite la couche de terre, l’humus, et s’ils existent c’est que ta terre est vivante et que tu peux potentiellement faire un jardin ensuite. Mon travail se résume à ça finalement, on fait des élevages de collemboles. C’est invisible mais essentiel.
Travailler un jardin, c’est avoir une compréhension scientifique précise que l’on vient ensuite poétiser. A un moment, l’ensemble des connaissances scientifiques acquises va pouvoir permettre de jouer avec. Et ce qui m’inquiète avec la nouvelle vague de paysagistes ou amateurs de permaculture ou encore l’essor de l’éducation de la plante à l’école, c’est qu’ils ne sont pas suffisamment sachants. Cela risque de faire plus de dégâts qu’autre chose. C’est comme le solfège, une fois que tu le connais, tu peux improviser, mais pas avant.
Ensuite c’est une sorte de mise en scène très réfléchie. On va choisir l’endroit où l’on a envie de partager telles odeurs, tels points de vue. Comme la composition d’un intérieur ou d’un tableau qui prendrait vie.
Et ensuite, comme a dit Alain Richert “La qualité d’un jardin s’apprécie à la sérénité de ses oiseaux” L’envers de l’endroit – éloge de l’incertitude. p.87
Sur le site d’Amare Horto, Tu as une charte très précise que tu définis uniquement dans ce que tu ne veux pas faire…
Je pense qu’on se définit par ses “non” dans la vie. On ne sait jamais ce qu’on va faire mais on sait ce qu’on ne veut pas faire.
Dans le jardin, l’agriculture ou l’architecture, si tu ne dis pas non à des pratiques absolument démocratisées, tu fais mal ton métier finalement. Dire “non, je ne fais pas du pétrole,” “non je ne retourne pas la terre” … c’est dire je m’occupe des collemboles, je me préoccupe du vivant, c’est refuser de nuire tout simplement.
On te demande souvent d’aller à l’encontre de tes principes ?
Tout le temps ! La demande qui revient le plus souvent c’est de retourner la terre, soit exactement le contraire de ce qu’il faut faire. Par exemple ; des personnes viennent d’acheter un terrain, ils ont fait construire la maison, les ouvriers ont abimé tout le jardin, ils souhaitent retourner le terrain et planter du gazon. Alors qu’il faudrait, selon le terrain, soit faire un lit de BRF (Bois Raméal Fragmenté) pendant deux trois ans, c’est beau, ça fait un champs fleuri magnifique, cela va régénérer le sol, faire revenir les collemboles, après le passage des chenilles … et à ce moment-là on peut envisager de faire un jardin. Les solutions plus rapides sont les buttes. Il ne faut surtout pas toucher la terre il faut la couvrir
Si on te commande un jardin à la française, est-ce que cela entrerait dans ton éthique ?
Tout dépend du client. Si on ancre cette démarche dans une réflexion intéressante et éco-responsable, c’est tout à fait envisageable de faire de beaux jardins à la française. Après, c’est intéressant aussi de détourner le jardin à la française pour qu’il soit plus intelligent, plus naturel et bien plus vivant. Amare Horto a expérimenté ces réinterprétations dans des jardins d’hôtels particuliers à Vincennes et ça fonctionne super bien. Il faut qu’il y ait un accord et une confiance avec le client sur les principes que je défends.
Quelles sont les grandes évolutions qui ont modifié le métier de paysagiste ?
Les grandes découvertes pour les arbres sont très récentes.
Avant 1995, on ne savait pas ce qu’était qu’un arbre. On a commencé à le savoir grâce à Francis Hallé.
Deux découvertes notoires :
Les arbres n’ont pas un génome fixe. D’une branche à l’autre, il n’y a pas forcément le même gène. Ce qui signifie que l’arbre n’est pas un individu, il n’a pas de début, pas de fin. Découverte fondamentale.
La principale source de carbone de l’arbre vient de l’air. La lumière avec l’aide de la chlorophylle est source d’énergie, mais ça on le savait déjà.
Ce que l’on sait aussi maintenant c’est que l’arbre n’a pas de programme de sénescence, pas de vieillissement cellulaire, il ne meurt que de causes extérieures à lui-même, le vent, les accidents, les glissements de terrain, les coupes humaines…
Que penses-tu des actions de végétalisations dans les milieux urbains ?
J’attends que l’on pense dans l’autre sens. Que l’on urbanise sur du végétal et non l’inverse.
A Londres, lorsqu’on voit certaines rues où les habitants se réapproprient l’espace, végétalisent leurs rues, et font planter des tomates, on commence à renverser la balance.
Dans les maisons de bambou dans la jungle, on voit que les constructions respectent le vivant et s’y adaptent sans le modifier. L’urbanisation vient sur la végétalisation. Autre exemple, la maison japonaise, est construite par rapport à son jardin et non l’inverse.
A une échelle complètement différente, on peut retrouver cette sensation au Central Park de New York où l’on a le sentiment que la ville a été construite autour du jardin.
Que penses-tu de la manière dont les architectes intègrent le végétal dans leur construction ?
Il me semble qu’il y a toujours, malgré les efforts, cette sensation que l’architecte essaye d’imposer sa supériorité sur le paysage. Je ne me suis pas encore dit en voyant un immeuble arboré que l’architecte avait vraiment compris ce qu’il faisait. Je pense à beaucoup d’immeubles qui longent le périphérique, sur lesquels on a tartiné de manière irréfléchie des arbustes.
Nous, contrairement aux architectes, on ne fait pas des dessins on fait des jardins. J’ai toujours le sentiment que les arbres plantés sont uniquement le langage du plan de l’architecte et non d’une réelle réflexion sur le vivant implanté. Il faut s’intéresser à la terre dans laquelle on va planter, donc aux bêtes, aux champignons et aux bactéries qui y vivent.
A la Bibliothèque François Mitterrand, on voit tout de suite que le concepteur du jardin avait compris tout cela. Ce qui est très réussi à la BNF c’est que le cœur du projet est un jardin protégé où l’homme n’a pas accès.
Je pense que ça a été une grosse erreur d’associer les deux métiers par le titre d’Architecte-Paysagiste alors que ce sont deux métiers et deux savoirs très distincts. Ce titre permet à l’architecte de concevoir un mauvais paysage et inversement.
Être paysagiste, cela demande d’être à la fois scientifique et poète. Et l’architecte n’a pas le savoir suffisant pour planter le bon arbre au bon endroit, d’ailleurs souvent il ne se pose pas la question.
Quel doit être le lien entre l’homme et la nature ?
L’homme doit encore trouver sa place par rapport à la nature. Les arbres et les plantes lui sont bien antérieurs. Il doit se tenir, de manière humble, à l’écart de certains processus naturels. Par exemple, lorsque nous créons des buttes c’est pour décourager le piétinement et ainsi laisser faire la nature. Jamais l’homme n’a eu une action bénéfique sur la forêt.
Y a-t-il un bâtiment qui t’as particulièrement marqué ?
Une cabane de bambou à flanc de colline quelque part dans le nord de la Thaïlande. Cabane uniquement construite en bambou, entourée de bananiers et perchée à plusieurs mètres du sol. On s’y sent comme un oiseau. Le bambou permet de voir à travers le sol et les murs et donne une atmosphère ombragée et vibrante à l’intérieur des pièces. Les cabanes sont grandes et desservent plusieurs pièces. Elles sont construites sur deux étages : l’étage inférieur qui abrite les espaces d’habitation moins nobles comme les toilettes, les ateliers avec les outils etc et au première étage les pièces de vie.
Qu’est-ce que tu rêverais de faire en tant que paysagiste ?
Il y a un projet sur lequel nous travaillons en ce moment qui me plait beaucoup. Nous travaillons pour une entreprise de recyclage de matériaux dont les locaux sont près d’Orly. Ils nous ont proposé d’aménager au milieu de conteneurs en tôle 200m2 de terre. Nous voudrions créer une forêt de 200m2 avec un amphithéâtre au milieu. Ce projet est excitant.
Mon autre rêve serait de créer un parc public.
Quelle serait la gestion idéale d’une forêt ?
D’abord, il faut bien connaître sa forêt en répertoriant les arbres, repérer les plus vieux, dégager autour d’eux pour les protéger.
Cela nécessite d’avoir une forêt la plus libre possible avec plusieurs essences. Il faudrait ensuite prélever un quota bien défini d’une certaine espèce par hectare, en fonction de son âge. On laisse les arbres s’écrouler et pourrir, cela nécessite de perdre certains arbres mais l’on sait que c’est productif.
Aujourd’hui, quelques producteurs utilisent cette méthode, mais c’est du bois qui va être réservé pour des luthiers. Ils choisissent les arbres, pendant 30 ans ils les regardent pousser et un jour ils disent on les abat.
C’est pour ça que je n’achète plus de bois dans les réseaux mais directement auprès des scieries et des producteurs.
Que penses-tu des forêts de douglas ?
Il y en a partout en France. D’ailleurs on ne parle pas de forêt mais plutôt de plantations de douglas, ça n’a rien à voir avec une forêt. On peut taper dedans, peu importe car ce n’est plus vivant. Tout est entièrement mort. En revanche c’est un très bon bois de construction, et si on veut être responsable il faut acheter du douglas français. Parce que ces plantations existent, autant les utiliser.
Mais si tu achètes ce bois, cela ne va pas participer à la pérennité du commerce de ces plantations ?
En fait après la seconde guerre mondiale, la France n’avait plus de bois, tout avait été coupé et massacré. Nous avions besoin de produire pour reconstruire le pays. Nous découvrons un bois génial, c’est le plus grand pin du monde il tient à l’extérieur, à l’eau, il fait des poutres parfaitement droites et magnifiques de 30m de haut.
L’État pousse à la plantation des douglas pour relancer l’économie. On a bousillé des endroits où il n’y avait pas de forêts. C’est le cas du Morvan. Le Morvan c’était des bocages et des pâturages que l’on a remplacés par des forêts de douglas. Et supprimer les bocages c’est une catastrophe pour la faune. Les gens du Morvan en sont fous. Ça fait 60 ans qu’ils sont furieux.
Pour répondre à ta question ; étrangement le douglas français n’est pratiquement pas exploité par les grosses entreprises donc lorsque l’on achète ce bois, on est quasiment sûr de travailler avec des petites scieries. Et si on travaille avec une bonne scierie responsable, des bons producteurs qui ont acheté ces parcelles et qui à terme souhaitent les transformer en des parcelles plus responsables, il faut l’encourager et en acheter.
Ce qu’il ne faut pas faire c’est de continuer à autoriser les entreprises à planter un plan au mètre linéaire en ligne sur des espaces gigantesques.
A long terme, l’objectif étant de faire disparaître ces plantations de douglas.
Le bois français qui pourrait remplacer le douglas dans le milieu de la construction, c’est le chêne ?
Oui mais c’est plus cher et il n’y en a pas suffisamment. Je travaille régulièrement le chêne mais il faut que mes clients acceptent de payer trois ou quatre fois le prix. L’avantage aussi avec le chêne, c’est que la poutre est deux fois plus fine que celle du douglas car ses cernes sont beaucoup plus denses et solides. Une autre différence, dans les pins il n’y a ni bois de cœur ni aubier, le bois est le même partout.
Qui sont ceux qui t’inspirent ?
Francis Hallé, botaniste, biologiste et dendrologue français. Auteur de Eloge de la plante, 2014, Plaidoyer pour l’arbre, 2005.
Alain Richert, Architecte-paysagiste et enseignant. Auteur de L’envers de l’endroit, éloge de l’incertitude, 2015. Au-dessus des Parcs et Jardins de France, « une anthologie de toutes les typologies possibles de jardins dans l’Hexagone ».
Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français. Selon Gilles Clément, le jardin en mouvement est un « état d’esprit » qui « conduit le jardinier à observer plus et jardiner moins. À mieux connaître les espèces et leurs comportements pour mieux exploiter leurs capacités naturelles »
Akira Miyawaki, botaniste japonais expert en écologie végétale et rétrospective, spécialiste des graines et de l’étude de la naturalité des forêts. Auteur de The Healing Power of Forests: The Philosophy Behind Restoring Earth’s Balance With Native Trees, avec Elgene Owen Box, 2007
Bruno Sirven, Géographe spécialisé dans le domaine du paysage et de l’environnement. Auteur de Le génie de l’arbre, 2016.
Notre génération est aujourd’hui confrontée à différentes formes de déséquilibres qui ont considérablement modifiés les données que nous devons prendre en compte en tant qu’architecte.
L’agence Déchelette Architecture ressent la nécessité de questionner et d’enrichir sa pratique auprès d’experts et de passionnés dont la vision et les savoirs sont porteurs de remise en question, d’espoir, d’ingéniosité et d’engagement.
Au travers de ces entretiens, nous espérons alimenter un savoir commun dans un esprit de recherches, de partage des expériences et de synergies entre les différents acteurs.
n.f. Composé à l’aide du grec Atmos, “ vapeur (humide)” et spharia, “Sphère (Céleste)”. - Ensemble de couches, principalement gazeuses, qui entoure la masse condensée, solide ou liquide d’une planète - Couche d’air qui environne - ToutFluid subtil et élastique qui enveloppe un corps et en suit les mouvement.
- Milieu où l’on vit, dans la mesure où il exerce une influence moral sur les êtres qui s’y meuvent.
n.f. Emprunté de l'Allemand Ökologie, formé à l’aide du grec oikos, “maison, habitat”, et logos, “discours”.
- A l’origine, partie des sciences naturelle qui étudiait les rapports de l’animal avec son milieu. Le terme “écologie” a été crée en 1866 par le biologiste allemand Heackel. Par ext. Science qui étudie les corrélations entre les êtres vivants et le milieu qui les entoure.
- Etude des conditions nécessaires au développement harmonieux des êtres vivants : mesures propres à assurer la survie des espèces existantes, élimination des facteurs qui menacent l’équilibre biologique, etc.
n.m. Propriété particulière d'un objet qui fait que celui-ci occupe une certaine étendue, un certain volume au sein d'une étendue, d'un volume nécessairement plus grands que lui et qui peuvent être mesurés. - Étendue, surface ou volume dont on a besoin autour de soi. - Portion de l'étendue occupée par quelque chose ou distance entre deux choses, deux points.
n.f. du grec ancien sunergia, “coopération”, lui même composé de Sun, “ avec” et ergasia, “travail”.Mise en commun de plusieurs systèmes, organes ou actions pour l’accomplissement d’une même fonction. Coopération, interaction bénéficiaire.
n.m. du latin patrimonium, “héritage du père, patrimoine, biens de famille, fortune”. Le patrimoine est l'héritage commun d'un groupe ou d'une collectivité qui est transmis aux générations suivantes.
n.m. (latin ficus, figuier) genre de plantes faisant partie des Moraceae. Le genre comprend aussi bien des arbustes que des arbres ou des lianes. Avec plus de 750 espèces connues il s'agit, avec Dorstenia, d'un des principaux genres de sa famille. Ce sont principalement des plantes tropicales dont toutes ont en commun de produire des inflorescences et infrutescences particulières, les sycones ou figues.
n.m (grec kolla, colle, et de embolon, piston – en référence à la présence d'un tube rétractile enduit d'un liquide gluant sur leur premier segment abdominal.)
Insecte très primitif, sans ailes, sans yeux composés, en général sans trachée. L'ordre des collemboles existe depuis le dévonien ; ces insectes jouent un rôle capital dans l'équilibre biologique des sols, où ils abondent. Ils peuplent toutes les régions du monde, y compris les zones polaires et les déserts chauds et ont certainement les hexapodes les plus abondants sur Terre (jusqu'à 400 000 au mètre carré).
n.m. (latin. Boscus . Boscum . Bosc, Bois)
Type de paysage formé de champs et de prés enclos par des levées de terre portant des haies ou des arbres marquant les limites de parcelles de tailles et de formes différentes, à l'habitat dispersé en fermes et hameaux. Le bocage occupait une large part de la façade atlantique et de l'intérieur des terres. -littéraire, Petit bois ; lieu ombragé.
n.m. (latin. alburnum, de albus, blanc )
Partie vivante du bois, tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois dur ( le bois de cœur ou duramen) et l'écorce d'un arbre. C’est dans ce bois périphérique, plus jeune et plus clair que circule la sève brute.
Pseudotsuga menziesii est une espèce de conifère de la famille des Pinaceae, originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord. En français on l’appelle douglas vert pin de Douglas, pin d'Orégon ou douglas de Menzies.
C’est un arbre à croissance rapide qui peut atteindre de très grandes dimensions. Son bois possède de très bonnes qualités techniques. C’est un bois d’oeuvre qui permet des utilisations aussi variées que la charpente (traditionnelle et fermette), la construction navale, la menuiserie d’intérieur et d’extérieur, le placage, le plancher, le parquet, le poteau, le panneau contreplaqué ou lamellé-collé, le plafond, le lambris…C'est l'une des essences les plus importantes pour l'exploitation forestière et l'industrie du bois en Amérique du Nord. Il prend aussi de l'importance aujourd'hui en Europe.
L'arbre adulte atteint une taille moyenne comprise entre 50 et 80 m de hauteur pour un diamètre de 2 m dans ses régions d'origine, et actuellement entre 40 et 70 m de hauteur en Europe (la plupart des plantations sont récentes). Il pousse rapidement mais peut vivre entre 400 et 500 ans
Lexique
n.f. Composé à l’aide du grec Atmos, “ vapeur (humide)” et spharia, “Sphère (Céleste)”. - Ensemble de couches, principalement gazeuses, qui entoure la masse condensée, solide ou liquide d’une planète - Couche d’air qui environne - ToutFluid subtil et élastique qui enveloppe un corps et en suit les mouvement.
- Milieu où l’on vit, dans la mesure où il exerce une influence moral sur les êtres qui s’y meuvent.
n.f. Emprunté de l'Allemand Ökologie, formé à l’aide du grec oikos, “maison, habitat”, et logos, “discours”.
- A l’origine, partie des sciences naturelle qui étudiait les rapports de l’animal avec son milieu. Le terme “écologie” a été crée en 1866 par le biologiste allemand Heackel. Par ext. Science qui étudie les corrélations entre les êtres vivants et le milieu qui les entoure.
- Etude des conditions nécessaires au développement harmonieux des êtres vivants : mesures propres à assurer la survie des espèces existantes, élimination des facteurs qui menacent l’équilibre biologique, etc.
n.m. Propriété particulière d'un objet qui fait que celui-ci occupe une certaine étendue, un certain volume au sein d'une étendue, d'un volume nécessairement plus grands que lui et qui peuvent être mesurés. - Étendue, surface ou volume dont on a besoin autour de soi. - Portion de l'étendue occupée par quelque chose ou distance entre deux choses, deux points.
n.f. du grec ancien sunergia, “coopération”, lui même composé de Sun, “ avec” et ergasia, “travail”.Mise en commun de plusieurs systèmes, organes ou actions pour l’accomplissement d’une même fonction. Coopération, interaction bénéficiaire.
n.m. du latin patrimonium, “héritage du père, patrimoine, biens de famille, fortune”. Le patrimoine est l'héritage commun d'un groupe ou d'une collectivité qui est transmis aux générations suivantes.
n.m. (latin ficus, figuier) genre de plantes faisant partie des Moraceae. Le genre comprend aussi bien des arbustes que des arbres ou des lianes. Avec plus de 750 espèces connues il s'agit, avec Dorstenia, d'un des principaux genres de sa famille. Ce sont principalement des plantes tropicales dont toutes ont en commun de produire des inflorescences et infrutescences particulières, les sycones ou figues.
n.m (grec kolla, colle, et de embolon, piston – en référence à la présence d'un tube rétractile enduit d'un liquide gluant sur leur premier segment abdominal.)
Insecte très primitif, sans ailes, sans yeux composés, en général sans trachée. L'ordre des collemboles existe depuis le dévonien ; ces insectes jouent un rôle capital dans l'équilibre biologique des sols, où ils abondent. Ils peuplent toutes les régions du monde, y compris les zones polaires et les déserts chauds et ont certainement les hexapodes les plus abondants sur Terre (jusqu'à 400 000 au mètre carré).
n.m. (latin. Boscus . Boscum . Bosc, Bois)
Type de paysage formé de champs et de prés enclos par des levées de terre portant des haies ou des arbres marquant les limites de parcelles de tailles et de formes différentes, à l'habitat dispersé en fermes et hameaux. Le bocage occupait une large part de la façade atlantique et de l'intérieur des terres. -littéraire, Petit bois ; lieu ombragé.
n.m. (latin. alburnum, de albus, blanc )
Partie vivante du bois, tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois dur ( le bois de cœur ou duramen) et l'écorce d'un arbre. C’est dans ce bois périphérique, plus jeune et plus clair que circule la sève brute.
Pseudotsuga menziesii est une espèce de conifère de la famille des Pinaceae, originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord. En français on l’appelle douglas vert pin de Douglas, pin d'Orégon ou douglas de Menzies.
C’est un arbre à croissance rapide qui peut atteindre de très grandes dimensions. Son bois possède de très bonnes qualités techniques. C’est un bois d’oeuvre qui permet des utilisations aussi variées que la charpente (traditionnelle et fermette), la construction navale, la menuiserie d’intérieur et d’extérieur, le placage, le plancher, le parquet, le poteau, le panneau contreplaqué ou lamellé-collé, le plafond, le lambris…C'est l'une des essences les plus importantes pour l'exploitation forestière et l'industrie du bois en Amérique du Nord. Il prend aussi de l'importance aujourd'hui en Europe.
L'arbre adulte atteint une taille moyenne comprise entre 50 et 80 m de hauteur pour un diamètre de 2 m dans ses régions d'origine, et actuellement entre 40 et 70 m de hauteur en Europe (la plupart des plantations sont récentes). Il pousse rapidement mais peut vivre entre 400 et 500 ans
Notre génération est aujourd’hui confrontée à différentes formes de déséquilibres qui ont considérablement modifiés les données que nous devons prendre en compte en tant qu’architecte.
L’agence Déchelette Architecture ressent la nécessité de questionner et d’enrichir sa pratique auprès d’experts et de passionnés dont la vision et les savoirs sont porteurs de remise en question, d’espoir, d’ingéniosité et d’engagement.
Au travers de ces entretiens, nous espérons alimenter un savoir commun dans un esprit de recherches, de partage des expériences et de synergies entre les différents acteurs.
n.f. Composé à l’aide du grec Atmos, “ vapeur (humide)” et spharia, “Sphère (Céleste)”. - Ensemble de couches, principalement gazeuses, qui entoure la masse condensée, solide ou liquide d’une planète - Couche d’air qui environne - ToutFluid subtil et élastique qui enveloppe un corps et en suit les mouvement.
- Milieu où l’on vit, dans la mesure où il exerce une influence moral sur les êtres qui s’y meuvent.
n.f. Emprunté de l'Allemand Ökologie, formé à l’aide du grec oikos, “maison, habitat”, et logos, “discours”.
- A l’origine, partie des sciences naturelle qui étudiait les rapports de l’animal avec son milieu. Le terme “écologie” a été crée en 1866 par le biologiste allemand Heackel. Par ext. Science qui étudie les corrélations entre les êtres vivants et le milieu qui les entoure.
- Etude des conditions nécessaires au développement harmonieux des êtres vivants : mesures propres à assurer la survie des espèces existantes, élimination des facteurs qui menacent l’équilibre biologique, etc.
n.m. Propriété particulière d'un objet qui fait que celui-ci occupe une certaine étendue, un certain volume au sein d'une étendue, d'un volume nécessairement plus grands que lui et qui peuvent être mesurés. - Étendue, surface ou volume dont on a besoin autour de soi. - Portion de l'étendue occupée par quelque chose ou distance entre deux choses, deux points.
n.f. du grec ancien sunergia, “coopération”, lui même composé de Sun, “ avec” et ergasia, “travail”.Mise en commun de plusieurs systèmes, organes ou actions pour l’accomplissement d’une même fonction. Coopération, interaction bénéficiaire.
n.m. du latin patrimonium, “héritage du père, patrimoine, biens de famille, fortune”. Le patrimoine est l'héritage commun d'un groupe ou d'une collectivité qui est transmis aux générations suivantes.
n.m. (latin ficus, figuier) genre de plantes faisant partie des Moraceae. Le genre comprend aussi bien des arbustes que des arbres ou des lianes. Avec plus de 750 espèces connues il s'agit, avec Dorstenia, d'un des principaux genres de sa famille. Ce sont principalement des plantes tropicales dont toutes ont en commun de produire des inflorescences et infrutescences particulières, les sycones ou figues.
n.m (grec kolla, colle, et de embolon, piston – en référence à la présence d'un tube rétractile enduit d'un liquide gluant sur leur premier segment abdominal.)
Insecte très primitif, sans ailes, sans yeux composés, en général sans trachée. L'ordre des collemboles existe depuis le dévonien ; ces insectes jouent un rôle capital dans l'équilibre biologique des sols, où ils abondent. Ils peuplent toutes les régions du monde, y compris les zones polaires et les déserts chauds et ont certainement les hexapodes les plus abondants sur Terre (jusqu'à 400 000 au mètre carré).
n.m. (latin. Boscus . Boscum . Bosc, Bois)
Type de paysage formé de champs et de prés enclos par des levées de terre portant des haies ou des arbres marquant les limites de parcelles de tailles et de formes différentes, à l'habitat dispersé en fermes et hameaux. Le bocage occupait une large part de la façade atlantique et de l'intérieur des terres. -littéraire, Petit bois ; lieu ombragé.
n.m. (latin. alburnum, de albus, blanc )
Partie vivante du bois, tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois dur ( le bois de cœur ou duramen) et l'écorce d'un arbre. C’est dans ce bois périphérique, plus jeune et plus clair que circule la sève brute.
Pseudotsuga menziesii est une espèce de conifère de la famille des Pinaceae, originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord. En français on l’appelle douglas vert pin de Douglas, pin d'Orégon ou douglas de Menzies.
C’est un arbre à croissance rapide qui peut atteindre de très grandes dimensions. Son bois possède de très bonnes qualités techniques. C’est un bois d’oeuvre qui permet des utilisations aussi variées que la charpente (traditionnelle et fermette), la construction navale, la menuiserie d’intérieur et d’extérieur, le placage, le plancher, le parquet, le poteau, le panneau contreplaqué ou lamellé-collé, le plafond, le lambris…C'est l'une des essences les plus importantes pour l'exploitation forestière et l'industrie du bois en Amérique du Nord. Il prend aussi de l'importance aujourd'hui en Europe.
L'arbre adulte atteint une taille moyenne comprise entre 50 et 80 m de hauteur pour un diamètre de 2 m dans ses régions d'origine, et actuellement entre 40 et 70 m de hauteur en Europe (la plupart des plantations sont récentes). Il pousse rapidement mais peut vivre entre 400 et 500 ans


"Il y a beaucoup de richesse, la plupart des bâtiments démolis ne sont pas insalubres et ont encore une durée de vie. "
Anne Lacaton est architecte et associée de l'agence Lacaton et Vassal qu'elle créée en 1984 avec Jean-Philippe Vassal.
Ensemble ils prônent une architecture économe et défendent la transformation plutôt que la démolition.
Ils sont lauréats en 2021 du Prix Pritzker
1-Qu’est ce qui vous a donné envie d’être architecte ?
Je ne suis pas sûre que je savais très bien ce qu’était le métier d’architecte.
J’avais fait le lycée dans les sections maths et on m’orientait plutôt vers des études d’ingénieur. J’aimais bien tout ce qui était technique, scientifique, mais j’aimais aussi les cours de dessin ou de musique, et intuitivement, il me semblait que les études d’ingénieur étaient très techniques et qu’il manquait une dimension plus créative, même si ceux qui font des maths à un niveau très élevé y trouvent de la créativité. Mais, je ne le voyais pas comme ça.
Quand j’ai eu le bac, je me souviens être allée à l’université de Bordeaux avec mes parents. Ma sœur y faisait des études de lettres. En faisant le tour des écoles, on s’était arrêté à l’école d’architecture de Bordeaux, tout juste construite.
Elle avait une forme bizarre. A l’époque ça m’avait plutôt attiré. Je n’avais pas du tout de position critique par rapport à ça.
Quand on m’a expliqué ce qu’étaient les études d’architecture ça a attiré ma curiosité et ça m’a semblé correspondre à comment je me projetais dans un métier.
Il y avait de l’histoire, du dessin, de la géométrie, des maths et de la physique, aussi, des langues, et du mouvement. J’avais l’impression de me retrouver dans toutes ces disciplines et c’est dans cette variété que j’imaginais ou espérais l’intérêt d’un travail.
Les études étaient passionnantes. On a étudié juste après 68. Il y avait un vent de liberté et d’expérimentation partout dans les écoles. On sentait que tout était possible. C’est un très bon souvenir forcément. C’était une époque beaucoup plus optimiste qu’aujourd’hui, qui invitait à la curiosité, Ca a beaucoup compté dans notre éducation et notre approche de l’architecture. Aujourd’hui encore on est curieux de savoir toujours plus.
Finalement ça n’a jamais démenti l’idée que je m’en faisais à 18ans.
Jean-Philippe et moi nous avons commencé en même temps. Il avait eu un parcours un peu différent puisqu’il a grandi à Casablanca. A l’époque c’était une ville très moderne, avec beaucoup de jeunes architectes européens partis construire là-bas, fuyant une Europe encore conservatrice. Pendant son enfance il était complètement baigné dans cette architecture moderne. Il dit que c’est ce qui lui a donné envie de devenir architecte.
2-Vous avez monté votre agence tout de suite après vos études ?
Non pas tout de suite.
J’ai commencé faisant quelques petits projets, un petit projet d’extension pour mes parents, puis pour une amie. Je travaillais aussi à l’agence de Jacques Hondelatte, cela a été important. Ensuite avec Arc en rêve à Bordeaux. Je connaissais les fondateurs depuis l’Ecole d’architecture. Ils avaient monté cette structure associative entre la pédagogie, la formation et la culture, dédiée au public. Tout ceci a été important et m’a permis de fabriquer une expérience multiple.
J’allais souvent aussi rendre visite à Jean Philippe au Niger, qui était parti là-bas pour la coopération*. C’est une autre expérience très forte, un moment déterminant dans la façon dont nous avons abordé l’architecture par la suite.
Le Niger a été une nouvelle école. Une école où rien ne ressemblait à ce que l’on avait appris. Au début on pensait que ce serait un temps de passage, une expérience temporaire. Au bout d’un moment on a compris l’intérêt et l’importance de ce que nous apprenions. Cela a été fondateur de notre manière d’aborder nos projets.
Je pense entre autres à la relation au climat. Que veut dire réellement « vivre avec son climat » ? C’est une question que l’on n’expérimente pas ici en France. Lorsque l’on parle du climat c’est dans une approche plutôt de protection ou sous un angle assez technique de l’économie d’énergie et du réchauffement climatique. Mais on se situe rarement dans l’approche plus naturelle et plus fondamentale qui est de « comment créer un rapport amical et positif avec son climat ? ». Quand on habite dans des pays chauds, avec peu de technologie à disposition, on est obligé de voir autrement, de s’accommoder et de trouver une façon de vivre avec.
La créativité et l’ambition avec peu, ce sont des principes que l’on a beaucoup appris au Niger, qui sont beaucoup moins présents dans notre éducation ou notre culture d’européen. « Qu’est-ce que c’est l’essentiel ? » C’est une question déterminante que nous avons apprise et qui nous suit dans la façon d’approcher nos projets ensuite.
* La France entretient avec le Niger des relations historiquement privilégiées. Les deux pays sont liés par de nombreux accords, dans les domaines de la coopération culturelle, judiciaire ou encore de la défense. Les contacts entre responsables politiques à haut niveau sont nombreux et les visites bilatérales régulières.
3-C’est de là qu’est née votre philosophie du projet fondé sur l’économie du projet et la générosité des espaces ?
Oui, l’économie, l’économie créative, qui permet la générosité. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’économie. L’économie est un moyen. Le moyen de faire plus avec ce que l’on a. Dans les projets, nous partons toujours du principe de la générosité de l’espace. « Qu’est-ce que on veut pouvoir faire dans un espace, sans se contraindre, sans se gêner ? L’économie, c’est ce qui permet de réaliser cette ambition de générosité d’espace.
On se méprend souvent sur ce que veut dire « économiser ». On pense que ça veut dire : faire moins, ou moins bien, se restreindre. Ce n’est pas comme ça que nous entendons l’économie. Pour nous il ne s’agit jamais de réduire, de restreindre. L’économie est notre moyen créatif et salutaire qui permet de ne jamais abandonner les ambitions de projet sur la générosité de l’espace, de la lumière, des usages.
4- Comment faire pour être généreux dans des programmes avec des PLU très restreints ?
Les PLU sont de plus en plus restrictifs.
Cependant, il y a beaucoup de projets où l’on s’aperçoit que le programme ne remplit pas les droits autorisés.
Il y a quelques années, nous avons fait une opération de logement rue de l’Ourcq à Paris. Nous ne remplissions pas le maximum autorisé par le PLU et pourtant nous avons réussi à être très généreux dans nos propositions d’espaces.
Mais chaque fois que les règles évoluent, elles entrainent souvent un peu plus de restrictions.
Par exemple, il y a eu une époque où les jardins d’hiver n’étaient pas comptabilisés dans la surface de plancher. Cela faisait partie de la surface HORS d’œuvre. Ça nous permettait de jouer avec la réglementation en optimisant à la fois le droit à construire sur un terrain, et de créer de l’espace supplémentaire. La nouvelle définition de la surface SPD a réduit cela et supprime cette possibilité.
Mais il faut quand même insister et suivre ses intentions. A travers les projets, on arrive parfois à faire évoluer les règlements. Je me souviens d’un projet à Mulhouse, avec le maître d’ouvrage, un bailleur social, nous avions le souhait mutuel d’agrandir largement les logements et de pouvoir faire des jardins d’hiver assez grands. Le projet a convaincu la mairie de modifier le règlement, sans que cela n’affecte le voisinage, ni les hauteurs.
C’est vrai qu’il n’y a pas un cas pareil et que ce n’est pas toujours possible, mais il faut essayer et on arrive parfois à faire aboutir des solutions.
L’espace généreux est pour nous essentiel dans la conception des projets. On observe bien souvent dans les programmes que tout est toujours pensé au minimum. Le logement, bien évidemment, mais les autres programmes aussi. On s’aperçoit que c’est le résultat d’un travail très long de compromis entre l’expression des besoins, et le prix au mètre carré qui fait l’arbitrage, sans savoir ce qu’un projet peut proposer. Ça part d’un principe que tout mètre carré est identique, coûte le même prix, et ce prix au mètre carré détermine la surface que l’on pourra construire dans le budget et ainsi le programme. Cette hypothèse de départ qui n’est pas du tout pertinente, ou en tout cas beaucoup trop sommaire.
Il faut changer complètement cette façon de calculer le prix des bâtiments qui reste vraiment ancrée et jamais remise en question. Evidemment la question économique doit être posée dès le départ et les limites de budget, mais il faut démonter l’idée que « si vous construisez plus, le bâtiment sera plus cher.
Il faudrait donner beaucoup plus de marge au concepteur. Des programmes plus ouverts, qui ne prédéterminent pas un projet, mais décrivent les besoins, de manière large, et donner un budget à respecter scrupuleusement.
Le premier projet que nous avons réalisé au début de notre agence, était une maison à Bordeaux. Ce projet a été pour nous un extraordinaire champ de recherche et de travail. On avait discuté avec la famille. On leur avait dit que nous voulions faire autre chose qu’une maison standard minimum. Nous étions très motivés pour faire une maison beaucoup plus grande, plus ouverte sur l’extérieur, où ils auraient plus de facilité d’usage au quotidien. Ensuite il fallait y arriver. Donc on a rassemblé tout ce que l’on avait dans la tête, en se donnant toute liberté. Se rappeler comment font les gens en Afrique quand ils n’ont pas beaucoup : ils vont à l’essentiel. Etudier comment font les grandes surfaces pour construire des bâtiments efficaces et pas chers. S’inspirer de la performance de bâtiments agricoles comme les serres, pour gérer le climat.
A travers tout ça, on a cherché à comprendre précisément comment se fait le calcul du coût, quels sont les paramètres qui constituent le coût d’un bâtiment et le rapport entre le projet et ce coût : la complexité, la facilité d’exécution, la rationalisation et l’optimisation des éléments de la construction. C’est beaucoup plus précis qu’un coût moyen généralisé au mètre carré qui ne tient pas compte de la particularité d’un projet. Il faut être dès le début extrêmement précis et distinguer les choses par élément pour arriver à faire jouer les leviers. Ce premier projet a été vraiment très formateur pour nous.
5-D’où vient l’utilisation des matériaux industriels, verre, polycarbonate …
Ces matériaux souvent très performants, efficaces et économiques, par leur production en grande série, nous permettent de réaliser ce que l’on veut mettre en œuvre : des espaces plus grands, qui offrent plus possibilités, des grandes façades transparentes qui laissent passer la lumière et la vue, de la transparence et de la vue, des protections solaires ou thermiques efficaces, etc, que l’on ne pourrait pas réaliser avec des matériaux sur mesure. Ce sont aussi des matériaux de montage, qui facilitent le travail de construction.
Bien sûr c’est lié à l’économie mais pas uniquement.
Par exemple, le polycarbonate est un matériau très léger qui permet de faire de grandes surfaces transparentes, qui prennent le soleil et permettent la vue, avec beaucoup moins de structure que du verre.
Donc il y a l’économie mais il y a surtout ce que l’on attend d’un matériau, en quoi il répond aussi aux intentions du projet. L’économie du matériau ne veut absolument pas dire moindre qualité.
6-Quid des matériaux biosourcés.
D’une manière générale, nous nous sommes toujours attachés à employer le moins de matière possible dans la construction des projets. Nous cherchons toujours à faire des structures ouvertes de grande capacité pour réduire l’impact du matériau sur l’espace, ce qui sert aussi le projet d’espace plus grands. On a éliminé les murs qui contraignent définitivement l’espace et compromettent une évolution ou la reprogrammation dans le temps. Nous privilégions au maximum les solutions constructives de montage, qui permettent d’optimiser la matière employée et réduire l’effort de construction. Nous évitons le plus souvent les habillages rapportés et faisons-en sorte que ce qui constitue l’essentiel pour la construction, soit aussi ce qui est fini.
Aujourd’hui nous étudions aussi la solution de réaliser les structures en bois mais cela change la stratégie constructive, et aussi l’économie du projet. Il nous arrive de revenir à une structure béton et à de l’acier, mais la règle est toujours d’en utiliser le moins de quantité possible.
On cherche à minimiser l’impact des matériaux en poussant les études et les calculs pour qu’il n’y ait jamais de surplus.
Nous recherchons au maximum l’économie de quantité.
Les exigences actuelles d’utiliser des matériaux biosourcés ou issus du réemploi ne sont pas toujours adaptées à la réalité d’un projet, notamment quand on travaille sur un existant, et que l’on s’oblige à ne pas démolir et à utiliser sur site, ce qui est déjà là. On rencontre souvent un certain dogmatisme à vouloir tout ramener à des grilles de critères et d’évaluation, qui s’appliquent à des cas-types.
Tous les matériaux ont pour nous de l’intérêt, s’ils sont utilisés avec pertinence et économie. Les obligations quantitatives n’ont pas beaucoup de sens, si elles conduisent à utiliser plus de matériau que nécessaire.
Je pense que c’est très important d’avoir cette première démarche de parcimonie dans les matériaux employés, quels qu’ils soient et de ré-utiliser l’existant sur site au maximum. Si on utilisait mieux l’existant, sans démolition, on devrait avoir beaucoup moins de matériaux à ré-employer.
7-Qu’est-ce que l’architecture ?
Ce n’est pas une question facile. On peut passer sa vie à essayer de définir ce qu’est l’architecture.
Notre conception personnelle de l’architecture est de réaliser de l’espace pour la vie quotidienne, pour l’usage dans le sens qui touche au bien-être, au confort. L’architecture crée des relations et doit créer de bonnes relations en évitant les contraintes ou les restrictions. Nous nous intéressons aux espaces non fermés/non délimités/ouverts, avec l’idée d’une continuité permanente. Le dedans, le dehors, l’intime, le lointain, un sentiment de liberté, tout cela constitue la qualité d’un espace qui ne se définit pas par une entité délimitée par des matériaux.
Sur beaucoup de projets nous avons travaillé sur l’idée de l’échappement ; un lieu où à peine rentré on peut s’en échapper.
C’est pour nous une sorte d’obsession permanente dans la fabrication des projets : comment on s’échappe.
8-Quel est votre lieu préféré ?
J’aime bien en particulier les jardins. J’ai un beau souvenir des jardins du palais Topkapi à Istanbul. J’ai le souvenir d’un lieu magnifique, très simple, pas nécessairement ordonné, mais très poétique.
Parfois c’est quelque chose d’assez furtif quand on marche dans une ville, et qui reste.
De manière générale ce sont ces lieux qui échappent à la notion d’espace fermé. Des lieux qui créent la sensation que, après un espace, il y en a un autre, et un autre. Que ce n’est jamais fini.
9 -Quel conseil donneriez-vous aux jeunes architectes qui montent leur agence ?
Chacun se fait un peu comme il le veut avec son idéal, ses convictions, où il cherche à aller, ce qui l’intéresse. Je n’ai pas de conseils à donner. Je dirais simplement qu’il faut poursuivre idées et ses rêves.
Il y a aussi l’attention à porter aux autres, se rappeler que l’architecture est faite pour quelqu’un et non pour figurer. Cette conviction devient une occupation permanente, toujours nourrie par des projets, des sujets.
Je pense que c’est essentiel d’essayer de se construire sa propre approche, le sens qu’on veut donner à son travail. C’est compliqué, on passe par des hauts et des bas. Notre moteur a toujours été de se dire qu’il était important, à la fin d’un projet, d’être heureux de ce que l’on a fait, – ça n’exclut pas la critique- et d’avoir l’impression que l’on n’a pas perdu quelque chose en chemin.
Quand on est jeune il faut construire sa démarche, expérimenter et essayer de rester assez souple et libre pour précisément ne pas se contraindre dans des choses qu’on est obligé d’accepter car on n’a pas le choix. Malheureusement quand on est jeune architecte, il faut attendre trop longtemps l’opportunité de travailler et de faire des projets. Ce n’est pas normal.
10-Avez-vous senti des réticences par rapport au fait d’être une femme ?
J’ai sans doute eu de la chance mais je dois dire que je n’ai pas connu cette situation. Quelque fois des interlocuteurs se sont montrés surpris ou suspicieux, mais je n’ai pas eu à faire face à une situation de discrimination ou de non respect. Mes parents m’ont donné la confiance qu’être une femme ne devait jamais être un problème et n’ont jamais mis de réserve à ce que je souhaitais faire.
La situation des femmes en général dans beaucoup de milieux n’est pas bonne et ce qu’elle devrait être, le respect, l’égalité. Ce n’est pas acceptable.
En discutant avec mes étudiantes je vois bien qu’aujourd’hui cela semble plus compliqué qu’il y a 20 ans. C’est désolant, et c’est grave que rien n’avance.
11- Vous travaillez beaucoup sur la transformation en vous opposant à la démolition, pouvez-vous nous en dire plus?
Le sujet de la transformation est très important et depuis très longtemps et notamment depuis le début des années 2000 avec le démarrage des démolitions d’ensembles de logements modernes, dans le cadre de l’ANRU, nous sommes formellement opposés à la démolition et plaidé en faveur de la transformation. Parce que si l’on regarde attentivement il y a beaucoup de richesse et c’est une très mauvaise attitude de dire « on casse et on remplace ». Il y a la culture de conserver ce qui est ancien mais quand on arrive à une période plus récente ça ne marche plus.
Pour moi c’est absolument incontournable dans l’architecture et l’urbanisme, de partir de ce que l’on a déjà. La démarche est de considérer que l’on est dans des environnements construits, établis et qu’il faut partir de là et faire avec, apprendre à changer le regard d’analyse. Il ne faut jamais partir d’un présupposé négatif mais être curieux. Chercher toujours ce qu’il y a de beau et de positif dans l’existant.
Il y a eu depuis 20 ans un nombre très important de bâtiments et notamment de logements démolis, qui avaient encore une durée de vie possible, sans que cela suscite beaucoup de contestation ou d’opposition, sauf pour les gens qui y habitent et qui se battent avec beaucoup de force et d’engagement pour conserver leur habitation, sans être entendus. Ce sont des situations socialement très très dures.
Aujourd’hui la démolition est beaucoup plus critiquée, souvent pour des raisons écologiques ou de bilan carbone, mais il y en a encore beaucoup, et pas seulement en France. La démarche de réemploi qui se développe et devient presque une obligation dans les opérations, ne peut pas être une compensation. Au contraire, elle peut devenir un argument qui valide la démolition.
Un projet est aujourd’hui considéré plus vertueux dans le système des grilles de réemploi si l’on réemploie des matériaux ou des éléments provenant d’un lieu démoli ou déconstruit plutôt que de le conserver lui-même. Nous nous confrontons régulièrement à ces questions-là. Le plus performant est de transformer un site avec ses éléments, ré-employer sur site, sans démolir, plutôt que démonter pour réemployer ailleurs.
Il faut regarder ce que l’on a avec beaucoup d’attention parce que les lieux, les bâtiments, c’est aussi des gens qui les habitent. Cela concerne forcément les architectes.
12-Est-ce qu’il n’y a pas une limite à la démolition dans le cas de bâtiments complètement insalubres ?
Les bâtiments insalubres sont un cas très très particulier et minoritaire, ça n’a rien à voir avec les démolitions massives qui sont opérées. La plupart des bâtiments démolis ne sont pas insalubres et ont encore une durée de vie. Il ne faut donc pas se poser la question comme ça.
Il n’y a pas a priori de raison de remplacer. Il faut regarder chaque cas existant avec une approche réaliste et économe et surtout positive, qui part des valeurs existantes pour le faire évoluer. Transformer appelle aussi des solutions inventives.
Les calculs sont souvent faussés. Par exemple un éco quartier qui va s’implanter sur la démolition d’un ensemble de logements peut être jugé très vertueux mais parce que le bilan CO2 ne comprend pas l’antériorité, la démolition, le relogement, le déplacement des habitants.
13- Dans votre agence vous êtes nombreux ?
Non, nous n’avons jamais été très nombreux, peut-être 18-20 au maximum. Cela a été un choix de rester dans une taille où nous pouvions nous investir dans la conception tous les projets. Il y a un seuil d’équipe et de nombre de projets à partir desquels on ne peut plus suivre tous les projets. Donc on est toujours restés dans une petite échelle qui nous permet quand même de faire des projets de différentes tailles. De faire les projets les uns après les autres et de ne pas avoir à faire ce que l’on ne souhaite pas
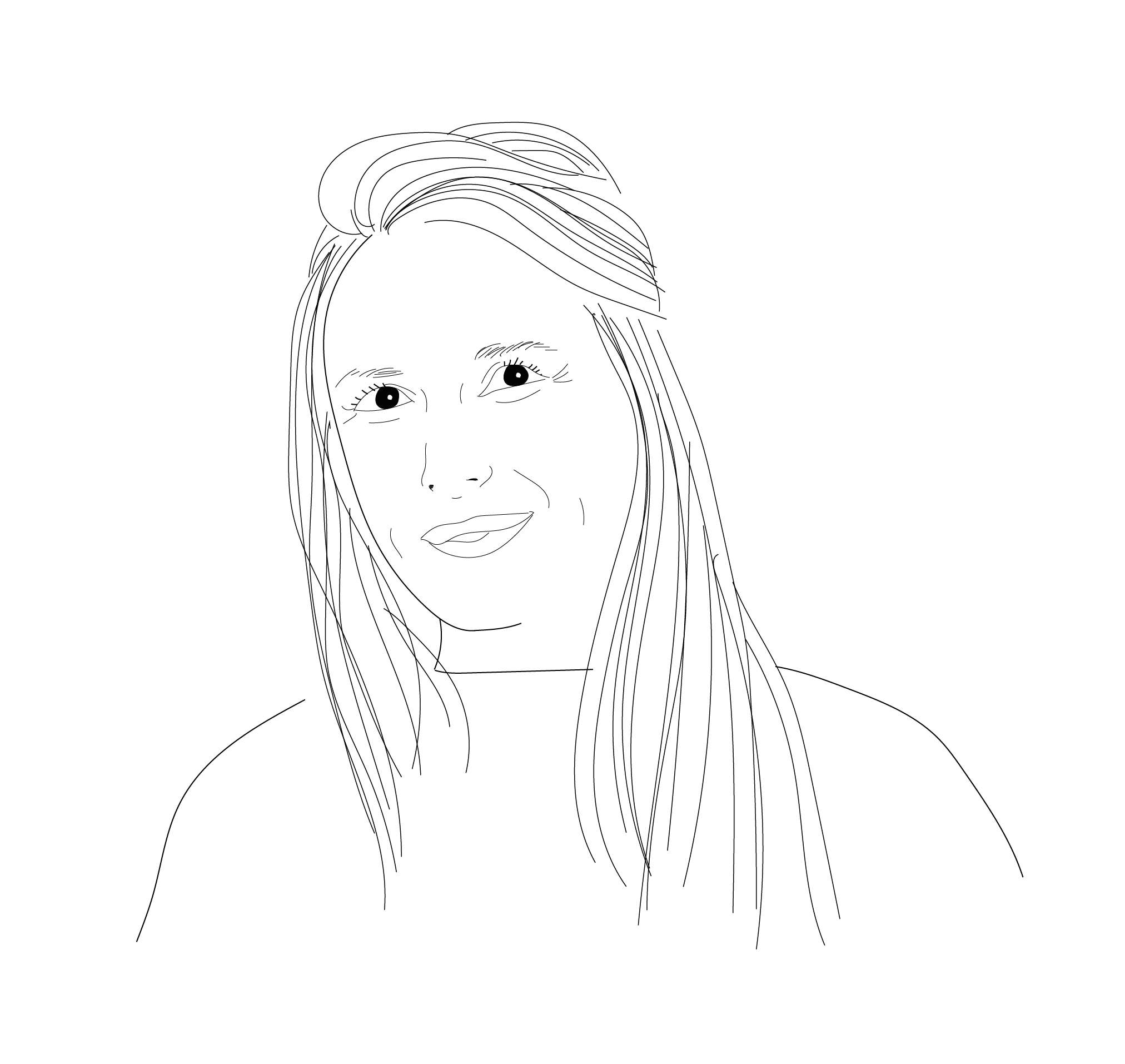
"Il faut se débrouiller pour proposer à des maîtres d’ouvrage des commandes qui n’existent pas"
Valentine Guichardaz-Versini est architecte et fondatrice de l’Atelier RITA qu'elle a créée en 2016 . Son agence a depuis remporté de nombreux prix l'Equerre d’Argent de la première œuvre en 2017 pour les Centre d'Hébergement d'Urgence d'Ivry-Sur-Seine. Elle est lauréate en 2018 des AJAP.
D’où vient le nom atelier Rita :
Ce nom vient de sainte Rita, c’est la sainte patronne de l’impossible et des causes désespérées. Je suis marseillaise et corse. En Méditerranée c’est une sainte qui est beaucoup priée. Je ne suis pas un brin catholique mais ma grand-mère, qui a une espèce de foi cachée, aime bien sainte Rita. Elle va souvent y poser des cierges et donc ça m’amusait de faire un clin d’œil à la fois sur la Méditerranée, sur les attributions de sainte Rita et pour rendre hommage à ma grand-mère.
« Sainte patronne de l’impossible et des causes désespérées » C’est un hasard par rapport à ton premier projet ?
L’agence a été créée à peu près au moment du début du chantier du Centre d’Hébergement d’Urgence. Mais c’est une coïncidence, j’avais déjà ce nom en tête deux ans avant de créer mon agence.
Tu as commencé en tant qu’autoentrepreneur ?
J’ai été diplômée en 2008. J’ai fait quatre ans de salariat. Au bout de quatre ans, je n’y trouvais plus mon épanouissement. J’ai eu envie de tenter des choses mais je ne savais pas quoi. J’ai commencé en autoentrepreneur en 2012 à Marseille, je n’avais pas d’ambition de monter une agence. Au bout de six mois – un an, j’ai pu vivre de ce que j’avais. C’était des petites choses mais ça m’a permis de me faire les dents. Un petit bout de réhabilitation d’une école privée, des appartements, des choses que l’on fait tous quand on démarre mais qui me plaisaient car c’était des échelles petites et maîtrisables qui m’ont permis de me mettre en confiance par rapport à ma pratique.
Et puis en 2013 je suis venue à Paris. Je ne trouvais plus vraiment mon compte à Marseille. Cela faisait 10 ans que j’y habitais. J’avais envie de m’ouvrir sur autre chose.
Comment s’est passée ta première année à Paris ?
La première année n’était pas évidente. Je ne connaissais absolument personne à Paris. J’ai fait des petits travaux dans une agence pendant quelque temps puis je n’ai pas travaillé pendant un an. Il fallait quand même gagner trois sous alors j’ai fait une peinture murale dans un hall d’immeuble. A la suite de ça, j’ai commencé à tirer un fil, puis deux, à des gens qui m’ont fait confiance.
Jusqu’au projet du Centre d’Hébergement d’Urgence à Ivry. C’est à ce moment que j’ai commencé à trouver quelle pouvait être ma mission en tant qu’architecte.
Comment as-tu accédé à la commande du Centre d’Hébergement d’Urgence d’Ivry ?
Ça m’est tombé dessus par hasard.
En 2016, je passais souvent devant le métro Stalingrad. Il y avait de plus en plus de personnes qui dormaient sous la passerelle. J’avais envie d’aider. Un jour, j’ai rencontré quelqu’un qui travaillait pour l’entreprise générale de construction Brézillon et qui avait monté un partenariat avec Emmaüs Solidarité. Il me dit « tu sais, tu es architecte, peut-être que ça pourrait les aider » et quinze jours après je suis allée avec lui au salon Emmaüs me présenter et tout de suite ça a collé. Ils m’ont appelée au début pour des petits projets comme une transformation de bureau en salle de lange, c’était minimal mais je trouvais ça intéressant de pouvoir aider comme ça.
Un jour j’ai reçu un mail disant « Est-ce que tu peux réfléchir à ce qu’on peut faire avec ça ? C’est pour 400 personnes, fais une étude de faisabilité et on voit », et c’est parti comme ça. J’ai donc commencé à dessiner avec du préfabriqué. Il n’y avait pas de concurrence parce que c’était plutôt des gens dans l’événementiel qui se positionnent sur ce genre de sujet, j’étais la seule architecte. Ce que je commençais à développer a tout de suite plu à Emmaüs. J’ai contacté mon ami de l’entreprise Brézillon pour lui demander si de son côté c’était possible de faire un chiffrage et de proposer ensemble un projet clef en main.
C’était super parce que nos partenaires d’Emmaüs nous ont fait confiance tout le temps, ils se moquaient complètement de mon chiffre d’affaires ou du fait que je n’avais pas d’expérience dans ce domaine-là.
C’était une sacrée aventure !
Et le chantier s’est bien passé ?
Oui le chantier s’est super bien passé. On a fait une conception-réalisation, ce qui d’habitude est un peu compliqué pour les architectes, mais qui là, était très adaptée. L’entreprise, très tôt, a pris part au projet, c’était efficace et on était dans la même équipe, on cherchait les solutions ensemble.
On était tous un peu dans le flou dans ce projet d’urgence. On s’est fait confiance et ça a fonctionné. L’équipe a été sélectionnée, je pense, à la fois par sa capacité à relever le défi de faire un chantier en quatre mois et à se dire « on va y arriver », et à la fois parce qu’ils étaient acquis à la cause et avaient envie de bien faire, dans les temps et avec générosité.
Combien de temps s’est écoulé entre le moment où on t’a proposé le projet et le moment où il a vu le jour ?
Il y eut deux mois d’étude et quatre mois de chantier. En six mois c’était fait, c’était très rapide. Nous avons livré une partie du projet en Janvier 2017, alors qu’on avait commencé le chantier en Novembre 2016. C’était très contraint comme temporalité.
Vous échangiez avec Julien Beller, l’architecte du CHU de la porte de la chapelle ?
Oui un petit peu. Nous nous sommes rencontrés à cette occasion. Mais nous n’avions pas de projet commun, ce n’était pas tout à fait les mêmes programmations, ni les mêmes temporalités d’hébergement, lui avait une convention d’occupation pour 18 mois alors que nous étions sur cinq ans. Les projets n’étaient pas pour les mêmes publics. Ses hébergements sont destinés à des hommes seuls alors que le CHU d’Ivry est destiné à des familles.
En revanche, sur le thème du projet, sur la complémentarité, sur le sens du projet, nous avons eu l’occasion de discuter, de faire des tables rondes.
Il y a deux typologies, une en yourte et l’autre en bois, quelles sont les différences ?
Je n’avais pas d’expérience dans ce type d’hébergements, je savais qu’il y serait logé des gens de la corne de l’Afrique, d’Afghanistan, de Syrie, des gens venant du bidonville Truillot d’Ivry qui a été démantelé ; des cultures très diverses allaient devoir se partager les lieux et je ne connaissais pas grand-chose à leurs différentes manières d’habiter. Il y avait donc deux solutions, la première d’étudier et d’affecter chaque culture d’habiter à une rue, mais ça aurait fait des rues pour les Erythréens, des rues pour les Afghans etc. et Emmaüs ne voulait pas de ça, ni même moi. La deuxième solution était de rendre les lieux les plus neutres et appropriables pour que chacun y vienne avec sa culture d’habiter sans que ce soit gênant pour les autres, ni une contrainte pour la personne qui y habite.
La structure d’un village est un invariant de l’habiter, tous les groupements humains fabriquent ces passages d’extraversion à introversion, de seuil progressif vers l’intimité.
On s’est dit que cette grande place sera une place centrale dans laquelle il y aura des éléments singuliers, comme des pavillons qui vont être des lieux de réfectoire, et qui vont marquer symboliquement, par leur forme, une différence avec le reste du centre d’hébergement. Sur cette place publique, on a aussi le pôle santé géré par le SAMU social, et un magasin de première nécessité, ce sont des installations de l’ordre de l’équipement sur cette place. Ensuite, il y a deux quartiers composés chacun de trois rues. Ces rues faites de modules bois sont larges de quatre mètres, pour instaurer un entre-deux entre l’espace de l’extraversion et l’espace de l’intime.
Il y avait deux batailles auxquelles je tenais et qui sont petites mais importantes, la première celle de conserver ces quatre mètres, pour accueillir le flux des gens qui montent et qui descendent, mais aussi accueillir de l’usage quel qu’il soit, qu’il ne soit pas tout à fait celui de l’espace public mais qui ne soit pas encore de l’espace privé. La deuxième était de pouvoir mettre de vraies portes palières pour rentrer chez soi, avec un petit tapis d’entrée, un espace pour déposer ses chaussures etc.
Et ça fonctionne plutôt bien comme ça !
Tu es allée rencontrer les habitants ?
Oui, j’y vais régulièrement. Il y a quand même la difficulté de la langue, on parle en anglais mais parfois c’est un peu compliqué. On a fait des interviews avec une quinzaine de personnes, j’ai des retours réguliers d’Emmaüs, de ceux qui travaillent sur place. Dans l’ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a un gros encadrement de la part d’Emmaüs ; 80 personnes y travaillent, donc ça aide. Les gens sont tous mélangés, il y a juste un côté famille et un côté plutôt pour les couples et les femmes seules.
Après, dans la programmation, le temps d’hébergement était de deux à cinq mois maximum, et le turnover était d’un mois et demi. Quand c’est réellement pour un mois et demi ça ne pose pas de problème, ça leur fait un moment de respiration et de repos dans leur parcours. Mais quand certains restent plus longtemps pour diverses raisons, ça devient compliqué car il n’y a pas de douche dans les modules, ce sont des douches communes, il faut prendre son repas dans les yourtes etc.
On a vu que tu as eu les AJAP en 2018, est ce que ça a été un accélérateur ?
On a eu un doublé entre l’Equerre d’argent de la première œuvre en 2017 et les AJAP en 2018. Je pense que ce qui a joué c’est la portée politique du projet, un projet atypique.
Mais oui, ça a été un boost, de passer de faire des fresques dans des halls d’immeuble à ça, on se sent un peu plus en visibilité et ça donne plus de légitimité à titre personnel. Ça m’a mise en confiance par rapport à ma capacité de faire de l’architecture, de faire correctement les choses, ça m’a rassurée. Et quand on est plus assuré, on arrive plus facilement à aller rencontrer des gens, pour dire « je suis architecte et je cherche du boulot ». En fait, ça a été plus un boost pour moi-même. Mais ça rassure aussi les maîtres d’ouvrage, vu qu’on est jeune, avec un chiffre d’affaires un peu bidon, ça les aide à nous faire confiance.
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes architectes ?
Aux élèves de PFE, j’ai tendance à dire qu’il faut qu’ils inventent quelque chose parce que la situation dans laquelle on est, est difficile. La situation financière des architectes est liée à une espèce de paupérisation parce que l’on arrive moins à trouver notre place dans les missions qui nous sont confiées. Il n’y a pas de reconnaissance de l’architecte.
Nous sommes arrivés à un point de rupture sur la manière dont nous travaillions jusqu’à présent. On ne va pas pouvoir reproduire le schéma de la génération précédente car il ne fonctionne plus. Il faut créer quelque chose, se débrouiller pour proposer à des maîtres d’ouvrage des commandes qui n’existent même pas. Il faut être là au bon endroit, au bon moment, ou volontairement aller chercher les projets ou les sujets de recherches qui peuvent eux aussi mener au projet. Tu vas fabriquer quelque chose.
Typiquement, pour le projet à Ivry, c’était des démarches qui n’existaient pas. S’il n’y avait pas un archi qui traînait là par hasard, ils n’auraient probablement pas pensé à faire ce CHU avec un architecte.
La question de la créativité de l’architecte en tant que créateur tout court se pose. Il faut dire « on va fabriquer notre commande, on va fabriquer notre métier ». Je pense que la génération qui arrive, et la nôtre qui commence à essayer de faire des choses, ont ça à faire.
Qu’est-ce que l’architecture pour toi ?
J’aborderais la question en faisant la différence entre l’architecture et être architecte.
Ma manière d’être architecte c’est de dire que l’on a une mission sociale, que l’on a un rôle à jouer de poil à gratter, d’emmerdeur, pour arriver à fabriquer le cadre de la ville d’aujourd’hui et de demain, le cadre de l’habiter qui va être en adéquation avec l’évolution de la société, les besoins des gens, l’usage et avec quelque chose qui serait aussi de l’ordre du dépassement, du laisser-faire, de voir comment les choses s’installent. C’est le cœur de la mission et c’est une vraie bataille.
L’architecture est immuable, c’est la discipline, c’est passionnant et c’est génial. Quand tu enseignes en licence c’est super, les étudiants découvrent tout et c’est merveilleux l’architecture. Après on devient architecte et c’est un peu plus douloureux parfois. Mais la passion est toujours là.
Justement que penses-tu du débat sur les charrettes qui font l’actualité en ce moment ?
Le débat est légitime. Les gamins qui ont vingt ans se posent des questions légèrement différentes de celles qu’on se posait nous. Nous on était un peu « il faut tabasser donc on tabasse ». Il ne faut pas dormir, on s’éclate la santé et ce n’est pas grave. Et eux se posent des questions de bien vivre, de bien être, et je trouve ça plutôt sain contrairement à certains collègues qui disent « ouais ils ne veulent plus bosser ». Je pense qu’ils se posent la question de comment bien vivre sans être l’esclave de quelque chose et ça vaut pour l’architecture mais aussi de manière générale comment ne pas être l’esclave de sa propre vie. Je trouve cette réflexion saine. Je le vois comme quelque chose de positif qui serait de l’ordre d’inventer un monde plus bienveillant pour chacun.
La culture de la charrette, je l’ai vécu. C’est-à-dire, tu en es ou tu n’en es pas.
Soit tu charrettes et tu en es, soit tu ne charrettes pas et tu n’en es pas. Personnellement, je n’en étais pas mais j’avais suffisamment de caractère pour dire je n’en suis pas mais je vous emmerde. Mais à cet âge beaucoup sont fragiles il y en a qui se disent que pour faire partie de ce groupe de reconnaissance et entrer dans la culture commune de l’architecture il va falloir passer par là. Donc ils s’abiment sévèrement la santé. Et cette culture perdure dans certaines agences.
Quel est ton lieu préféré ?
J’en ai plusieurs. Mon village en Corse qui s’appelle Partinello, un tout petit village perdu en Corse et je l’aime parce qu’il est perdu. Un de mes endroits préférés est sa plage toujours déserte. Elle n’a pas d’attrait particulier et du coup elle est à nous. D’une certaine manière, c’est là que je sens quelque chose en moi se réaxer. Tu regardes l’horizon, tu es dans ton sol et il y a quelque chose de biologique qui se passe.
Un autre endroit que j’affectionne particulièrement c’est l’Eglise d’urgence de Spitak en Arménie. Je l’ai découverte en faisant le tour de l’Arménie avec une amie arménienne. C’est une église qui a été construite en urgence dans le cimetière de Spitak qui était l’épicentre du tremblement de terre en 1988. Tout s’était effondré dans ce village. C’est un village perdu au milieu de rien. Il est très beau et surplombe un paysage de plaine immense désertique et lunaire.
On trouve d’un côté ce cimetière plein à craquer de personnes décédées à ce moment-là, donc déjà c’est fort. Puis il y a cette église faite en tôle sur le modèle de l’église apostolique en miniature comme une petite chapelle. C’est sublime. Je pense que c’est un de mes endroits préférés parce que ça m’a montré un certain nombre de choses sur la capacité de l’humain à fabriquer lui-même les conditions du symbolique. A la fois avoir du génie, à la fois avoir la manière de fabriquer avec ce qu’il a sur place à un moment M et de dépasser la simple question de se dire « on ne fait pas une boite à la con parce que c’est urgent, non il faut du beau. » Et ça, je crois que ça parle profondément de l’humanité.
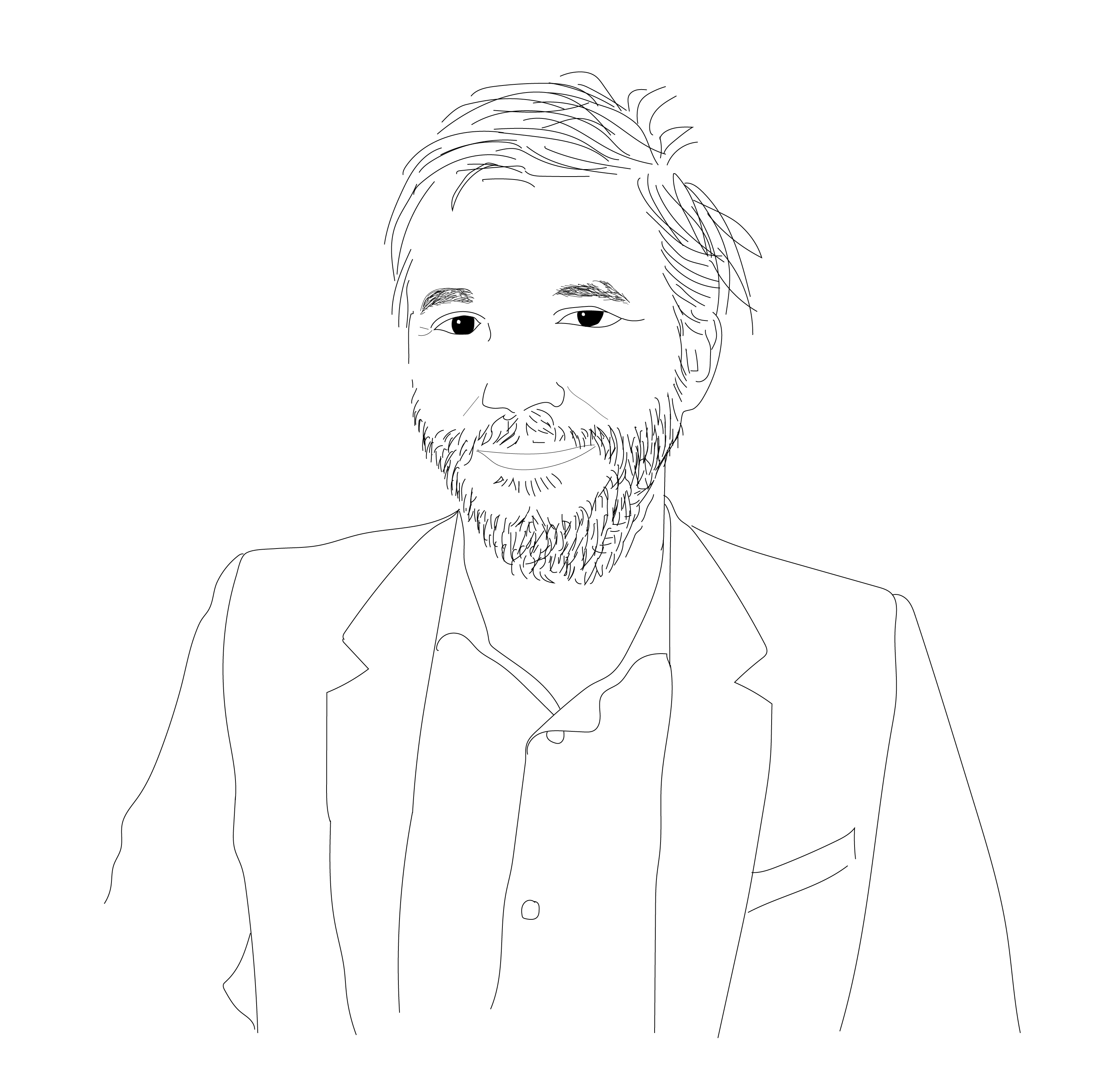
« Le privé est en train de prendre la main et de créer une nouvelle architecture»
Fabrice Long est architecte associé chez NP2F, agence qu’il a cofondé en 2009. Depuis, son agence a remporté de nombreux prix dont le prix Europan en 2008, l’AJAP en 2010 ou encore l’Equerre d’argent en 2016. Elle s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de l’architecture en France.
-Qu’est-ce que c’est l’architecture pour vous ?
L’architecture, c’est d’abord et avant tout une question d’usage. Notre rôle est d’organiser les usages et les fonctions dans un bâtiment, dans un lieu, une place. Cela a toujours été pour nous le seul but et le commencement de tout projet, avant la forme, l’objet ou l’esthétique : on s’attache d’abord à réfléchir à la fonction, à la taille des choses et à leur fonctionnement.
Pour autant, je crois que l’architecture est une question de gout avant tout. C’est un peu provoc, on peut facilement assimiler ça à du façadisme ou à de l’esthétisme superficielles mais il me semble que si l’architecte n’a pas de gout, il aura beau être super fort dans le côté fonctionnel, opérationnel ou technique, si son bâtiment est laid il sera laid et inversement un bâtiment qui n’est pas forcement incroyable en termes de puissance et de concept s’il est dessiné avec goût pourra avoir une certaine forme de réussite.
Le graal étant quand la fonction est puissante et l’esthétique l’est aussi. En tout cas je pense qu’il y a toujours une affaire de goût.
Si on va dans ce sens, alors le choix de la structure, de l’espace et de la fonction est lui aussi piloté par le goût. Ce n’est pas que la couleur de l’enduit, la couleur du carrelage qui vient en bout de course, mais tous les choix que l’on fait successivement.
L’architecture c’est d’avoir le souhait d’organiser la beauté à tout moment de la conception. Ce n’est pas un entonnoir où l’on met des choses et hop on en ressort une belle image, c’est un écosystème au sein duquel chaque étape est cruciale pour arriver à construire un beau bâtiment.
Si on n’a pas la conscience de devoir être beau pour moi on échoue.
-Quel est votre lieu préféré ?
Il y en a plein. J’aime un lieu lorsque j’ai le sentiment de percevoir l’intention de l’architecte, de sentir ce qu’il a voulu exprimer. C’est ce que j’ai ressenti à Saint Pétersbourg par exemple. Le fleuve de la Neva qui traverse la ville est très large, il fait 5 ou 6 fois la Seine, et les bâtiments autour font tous la même hauteur, ils sont assez bas, ils n’ont pas plus de 3 étages pour la plupart. Leur façade est un rectangle parfait très fin et très long. Ainsi je me suis dit que c’était un souhait de la ville, de l’urbanisme de dessiner une sorte de velum. C’est impressionnant de maitriser à ce point-là un ouvrage aussi grand et qui impacte autant le profil de la ville.
-Quand et pourquoi avez-vous décidé de monter votre propre agence ?
On a monté notre agence l’été après le diplôme, on travaillait dans différentes agences, et en parallèle, on commençait à réfléchir à notre agence, on faisait aussi des petits appartements.
Nous sommes passé sur l’émission Capital sur M6 grâce à un de nos appartements. Il s’agissait d’une émission sur la crise, les petits logements, la baisse des surfaces et comment se débrouiller dans les petits espaces. Le Lundi suivant, on a reçu beaucoup de mails, et beaucoup d’appels. Suite à ça nous nous sommes lancés quasiment à plein temps. Les 5-6 première années, nous avons surtout faits des petits appartements. C’est essentiel mais ça prend du temps et les clients ne sont pas toujours faciles à gérer. Ils pensent souvent qu’ils sont ton seul client, te sollicite les week end, la nuit parfois pour être rassuré sur la mauvaise position de telle applique…
Et puis on avait envie de dessiner de belles choses, d’inventer. Pour nous c’était un peu compliqué de dessiner pour quelqu’un. On a ressenti le besoin de s’exprimer en notre nom.
-Comment vous répartissez vous les taches entre les 4 associés ? Et quand avez-vous mis cela en place ?
De manière générale, on conçoit tout le temps tous les 4. On s’est ensuite chacun de nous un peu spécifié, notamment par rapport à nos penchants, certains sont plus dans la prospection et d’autres plutôt dans la conduite des projets. on écrit un peu chaque jour notre cohabitation.
-Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus dur en commençant ?
Le plus dur c’est de comprendre ta marge de manœuvre. Qu’est-ce que tu peux faire avec le client, jusqu’où tu peux aller. L’impact que tu as.
Mais plus ça avance et plus on s’en rend compte que l’on peut avoir du poids, notamment avec les marchés publics où les clients sont complètement respectueux de ce que tu fais. Ils nous ont toujours dit : « on ne juge pas l’architecture, nous on arbitre les finances et les typologies d’appartements, on vous dit notre cahier des charges mais l’architecture vous la faite tout seul ». Nous sommes seuls maitres à bord. Le chantier IMVT par exemple, le projet n’a pas changé d’un iota depuis le concours. On se bat depuis 3 ans pour que ce que l’on a imaginé soit le bâtiment construit et le client qui est le ministère de la culture nous a toujours laissé faire. Donc l’architecte à un vrai poids une vraie force, mais c’est dur d’assumer cette force au début de sa carrière. On est timide, on n’ose pas. On est beaucoup soumis au clients, à leur souhait à leurs demandes plus ou moins raisonnables.
Plus tu avances plus tu as des gros clients, plus ils savent ce qu’ils veulent à ta place et plus c’est une bataille. Peut-être que si tu es Chiperfield ou Rem koolhas tu peux commencer à avoir un pouvoir de persuasion plus fort.
Nous on a de plus en plus envie de dire que c’est nous qui décidons en tout cas, et de dire que l’on peut ne plus tout accepter aussi par militantisme parce que c’est notre devoir de défendre l’architecture et le fait que l’architecte puisse jouer un rôle fort dans la conception des bâtiments.
-Avez-vous eu le sentiment de manquer d’expérience sur les premiers chantiers ?
Oui souvent, mais cela ne nous a pas empêché d’agir pour autant. En fait c’est assez facile un bâtiment, cela reste basique, on est pas en train d’opérer un patient à cœur ouvert comme un chirurgien. Et puis on est aidé, plus le projet est gros et plus les BET sont un soutien technique fort.
Finalement c’est plus de stress que de difficultés.
-Comment êtes-vous parvenu à accéder à la commande publique ?
Premier concours public avec Poitevin, le CNAC l’école du cirque à Châlons-en-Champagne.
Je dirais que c’est un ensemble de choses. On a commencé par les petits appartements puis des petits concours comme Europan, les AJAP. On n’a jamais su dire s’il y avait eu des retours par rapport à ça, si ça nous avait directement ramené des marchés ou non mais c’est important de gagner ce genre de concours, c’est galvanisant. Et puis ça cristallise ta position, puis tu fais des projets de plus en plus gros, une étude pour un promoteur privé et ainsi de suite.
Le premier concours que nous avons réussi était le CNAC, pour l’école du Cirque de Châlons-en-Champagne pour lequel nous nous sommes associés à Mathieu Poitevin. Les collaborations c’est important au début de sa carrière d’architecte.
-Qu’est-ce qui vous inquiète le plus en tant qu’architecte ?
Ce qui m’inquiète c’est de constater que l’état a de moins en moins d’argent et mène de moins en moins de projets, ce qui laisse toute la place au privé. Or à mon sens aujourd’hui le secteur privé n’est pas assez vertueux pour que l’architecture continue à exister telle qu’on l’imagine. Le premier intérêt d’une boîte privée est le profit, ce qui ne permet pas à l’architecture de s’épanouir de manière saine ou intéressante à mon sens.
Nous la vision que l’on a de l’architecture, si je la vulgarise, est plutôt une architecture industrielle, d’ossature avec de très grande baies. C’est plutôt une structure qu’un bâtiment. Forcement c’est très cher par ce que ce sont des grandes hauteurs, des grandes baies des grandes vitres, c’est peu de murs. Le promoteur, lui, il veut des murs très épais, des petites fenêtres, des petites hauteurs sous plafonds et du coup c’est compliqué de faire de l’architecture avec les pires règles que l’on t’impose.
-Comment voyez-vous l’évolution de la profession ?
Je ne sais pas, je ne suis pas assez visionnaire pour le savoir. Le privé est en train de prendre la main et de créer une nouvelle architecture. On peut tout imaginer. Est-ce que demain il y aura des promoteurs architectes ? Des auto-constructions de gens qui s’assemblent et qui financent un projet qui sera du coup très libre et très beau ? Est-ce qu’il y aura des promoteurs éclairés qui vont vouloir être écologistes, moins marger et faire des beaux bâtiments ? Tout ça pour dire que je ne sais pas ce qui arrivera mais j’espère que l’architecture continuera à exister de mille manières car c’est l’affaire de tous, les gens y sont sensibles.
-Comment vous est venu la mise en place du style graphique qui vous caractérise ?
On fait beaucoup des collages, car à tout moment du dessin on a besoin d’éprouver ce que l’on dit. Notre réflexion part d’une image, d’un collage rapide. Si on cherche des structures il nous arrive on de faire jusqu’à 5 esquisses de différentes structures. Pareil si l’on parle de la taille de chose, d’empilement de plusieurs programmes ; avant de décider on le construit en image et on voit si c’est harmonieux par rapport au quartier, au bâtiment qui est en face, à la place qui est en bas etc.
-Vous construisez beaucoup en béton, est ce que on vous le reproche pas de plus en plus ?
Il y a un réel problème de coût. Peu de décideurs et de financeurs de l’architecture et de la ville n’ont les moyens financiers pour mener à bien des projets 100 % bois. Il y a après beaucoup d’autres moyens d’être vertueux, sur la consommation du bâtiment, sur des matériaux plus locaux.
Par exemple pour notre projet d’Arena, il y a une réelle économie du volume bâti, réduit à son strict nécessaire, sans vide de construction.
-Quel conseil donneriez-vous aux jeunes architectes qui montent leur agence ?
Essayez d’avoir une ligne, soyez radical. Il faut écouter le client mais il faut savoir le brusquer un peu parfois.
« La philosophie de conservation renforce les convictions et les démarches écologiques »
Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques depuis 1990, Inspecteur Général des Monuments Historiques depuis 2003 et membre de l’Institut depuis l’automne 2019. Responsable de la Villa Médicis et des édifices français de Rome, du théâtre lyrique de l’Opéra Comique – Salle Favart (Paris IIe), du Domaine de Chantilly.
C’est quoi pour vous l’architecture ?
L’Architecture est l’espace de l’épanouissement de l’homme. Cette dimension apparaît encore plus clairement maintenant que nous sommes en temps de confinement. L’architecture est faite pour l’homme, et doit pouvoir offrir toutes les dimensions de l’habiter.
J’ai la conviction que l’architecture doit être un engagement et sans doute la recherche d’un absolu. Paul Valéry dans Eupalinos ou l’Architecte* établissait en 1923 une relation entre l’Architecture et la musique; la vraie architecture serait celle qui mobilise nos sens. La grande architecture est pour lui une expérience musicale.
Quel est votre endroit préféré ? Pourquoi ?
Tous les endroits où j’ai travaillé ont compté pour moi. Je suis toujours saisi par la richesse et la diversité des lieux.
Un endroit compte beaucoup pour moi c’est l’Atelier de Donald Judd à New York, dans l’ancien quartier industriel de Soho qui était à l’abandon dans les années 60. Toute une génération d’artistes se saisit de ce quartier d’architecture en fonte qui illustre la diffusion de l’architecture industrielle. Donald Judd s’installe dans un de ces bâtiments entrepôts. C’est le lieu où il va vivre et où il va créer et exposer sa pratique la plus radicale des arts plastiques. Il utilise des boîtes, en plusieurs matériaux, plutôt en métal, en contreplaqué et simultanément il engage une restauration extrêmement respectueuse de son bâtiment.
On peut être le créateur le plus radical, bouleverser l’histoire de l’art, renouveler la tradition tout en considérant que cette création s’incarne dans un lieu qui doit être traité avec le plus grand esprit de conservation. C’est cette dualité que je trouve très belle.
—
Quel a été le bâtiment sur lequel vous avez travaillé à vos débuts qui vous a le plus marqué ? Pourquoi ?
Ma première expérience de jeune architecte en agence m’a passionné. J’ai dû faire le relevé de la charpente de l’Église de Sizun, une charpente à berceaux lambrissés du XVème-XVIème siècle. J’ai découvert un matériau, une technique, des hommes de l’art les charpentiers et j’ai découvert que la charpente est une structure, qu’elle définit un espace. J’étais en fait saisi par la poésie de ces lieux, le comble est un espace perdu, ignoré, coupé du monde. Le drame de Notre-Dame de Paris remet au coeur ce lieu, la relation complexe qui existe entre architecture, matériau et structure et valeurs symboliques.
Qu’est ce qui vous a mené dans cette voie du patrimoine et de l’architecture ?
J’ai été attiré par l’engagement humaniste et sociétal que représentait l’architecture. Cette fascination que je ressens à regarder l’histoire de l’architecture, à essayer de comprendre ce qui est déjà là, ce qu’elle a à nous dire, occupe mon cœur et mon esprit.
Toute l’architecture et toute l’histoire doivent être regardées. J’étais convaincu que les monuments historiques doivent être en renouvellement permanent et qu’il faut regarder le monde actuel. Cette conviction m’a amené à m’engager pour les architectures les plus récentes qui ont le plus de difficulté à avoir une reconnaissance patrimoniale. Je suis impliqué de façon militante dans la défense de l’architecture du 20ème siècle.
Est-ce plus difficile de défendre des bâtiments modernes ?
Pour les œuvres du 20ème siècle, il n’y a pas eu ce travail d’oubli, de réinvention, de recherche architecturale et elles sont plus difficiles à comprendre, à appréhender et à juger. C’est pour cela qu’elles doivent être défendues. Le mouvement Moderne aujourd’hui est accepté mais la production de la fin du 20ème, par exemple le Postmodernisme, est en train de disparaître en totalité.
Comment collectez-vous les informations, en quoi consiste votre travail en amont, pour structurer les interventions ?
J’ai acquis la conviction que, l’architecture est complexité. On doit répondre par un travail de recherche qui permettra d’identifier cette complexité qui compose les éléments d’architecture. Avant d’émettre mon avis, j’essaie qu’il soit fondé le plus scientifiquement possible sur une recherche documentaire, archivistique, pluridisciplinaire et ce n’est que à partir de là que je construis ma compréhension de cet édifice.
Le plus souvent je découvre, même si c’est une architecture récente, qu’elle a déjà eu une vie et des transformations. J’essaie de comprendre aussi ce qu’est l’édifice aujourd’hui par rapport au moment de sa création, quelles sont les transformations qu’il a subies, je l’accepte comme une structure plus complexe.
A quel moment l’architecte des MH peut se permettre une interprétation, une subjectivité ?
On peut répondre que toute intervention sur un Monument Historique est un projet comme toute démarche architecturale. A partir de là, la personnalité de l’architecte et de son agence est engagée. Le Monument Historique a son identité propre et le projet doit respecter qu’il est un bien collectif, partagé. La démarche de restauration ne devrait pas être une volonté de se singulariser, c’est une démarche faite au profit de l’édifice.
Comment abordez-vous cette question de la responsabilité ?
La responsabilité, vis à vis du monument et de l’édifice, c’est cette étude approfondie qui permet d’en révéler toute la complexité. Ma responsabilité, c’est d’aller au fond des choses et d’avoir une analyse très profonde de cette architecture qui m’est confiée.
Mes interventions doivent être transparentes, lisibles, justifiées et documentées. Tout le monde doit pouvoir savoir ce qui a été fait. Mon engagement est de transmettre ces monuments, de les faire perdurer.
Selon vous quand la logique de conservation se justifie -t-elle ? tout le temps ?
Tout le temps ! Je pense que la logique de conservation est un enjeu philosophique.
Bruno Zevi nous dit de regarder toute l’histoire. Nous avons la chance en tant qu’architecte d’être confronté à l’un de ces jalons de l’histoire, à nous de pouvoir le transmettre pour que quelqu’un comme Bruno Zevi puisse le réécrire dans 50 ans. Pour cela, il doit être conservé, considéré comme une matière archéologique fragile qui doit être stabilisée et transmise. C’est une manière de passer de l’architecture au laboratoire ou à l’archéologie.
Au bout de combien de temps un Monument est considéré comme MH ?
Jusqu’à André Malraux, qui a totalement renouvelé notre regard, il n’était pas possible de protéger un édifice du 20ème siècle parce que il était écrit dans les textes que l’édifice devait avoir une valeur archéologique. Or il était difficile que la villa Savoye ou que l’unité d’habitations de Marseille de 1952 soient reconnus en 1965 comme une valeur archéologique. On a eu l’intuition qu’en supprimant ce paramètre il ouvrait le MH au 20è siècle. Il y aura toujours cette hésitation et cette interrogation sur le besoin de recul pour analyser une architecture. Aujourd’hui les architectures les plus récentes peuvent être protégées.
Qu’est ce qui participe à la longévité et à la force d’adaptabilité d’un bâtiment ?
Pour la durabilité d’un bâtiment, on va parler de sa qualité constructive, sa capacité à être entretenu, la question de la maintenance qui est sans doute liée à la question de l’usage.
Pour qu’un édifice perdure, il faut qu’il soit utilisé, mais l’utilisation peut être la remise en cause son usage historique. La Villa Médicis, qui était le palais des Médicis est devenue une résidence pour artistes. Tout édifice est transformable, la question est de savoir si cette transformation se fait au détriment des valeurs de cette architecture ou au contraire l’enrichit.
Sur quels bâtiments avez vous travaillé où il y a eu le plus de mutation d’usages au fil du temps ?
Un édifice récent ne va pas être très modifié alors qu’une grange cistercienne a pu avoir vingt vies différentes. On peut partir d’un édifice où l’évolution d’usage est le plus limité possible, comme la maison Laroche, construite par Le Corbusier, qui s’est cristallisée, muséifiée.
Sur la Bourse de Commerce- Collection Pinault, sur laquelle je travaille en ce moment pour la partie conservation et dont la création est conduite par Tadao Ando et l’agence Nem, les changements ont été importants. Cette ancienne halle aux blés a été transformée en 1889 par Blondel pour la Bourse du Commerce de Paris. Cet usage, maintenu jusqu’à une période récente va basculer dans un renouvellement culturel. Il s’agit d’un changement d’affectation radical pour introduire l’art le plus contemporain au cœur de Paris. C’est un renouvellement architectural, urbain et patrimonial avec pour enjeu d’écrire cette nouvelle fonction sociale et de la mettre en dialogue avec l’histoire. C’est un projet de création et de conservation.
Avez-vous senti une évolution de la pratique ?
Oui, c’est une pratique radicale. Tout d’abord, le patrimoine est devenu un sujet partagé. La Journée du Patrimoine et les émissions dédiées introduisent dans le débat actuel une pratique démocratique.
Deuxièmement, il y a eu l’évolution du monde savant qui a fait comprendre que la matérialité était une dimension essentielle du patrimoine. Aujourd’hui il s’agit de conserver et non pas de reconstruire les monuments.
Troisièmement, nous faisons des métiers ou la pluridisciplinarité ne cesse d’augmenter. La complexité des projets nous impose de travailler avec des spécialistes et nous devons assumer notre responsabilité.
L’intérêt pour le patrimoine construit semble aujourd’hui se lier inévitablement à la préoccupation écologique, dans une logique d’économie de matière, de valorisation du “déjà-là”, d’incitation à la modération, la sobriété et la modestie des interventions qui semblent les mots forts de la création architecturale de ce nouveau millénaire.
C’est très juste.
Le patrimoine doit affirmer ses valeurs en termes de développement durable. Il privilégie le “déjà-là”. La philosophie de conservation renforce cette conviction et les démarches les plus récentes engagées dans le remploi des matériaux déposés ou issus de démolitions constituent pour moi des démarches patrimoniales.
Même dans le choix des entreprises et de la main d’œuvre. Il s’agit de transmission des savoir faire ancestraux et locaux et d’entreprises française. C’est aussi en ça que c’est une pratique plus “écologique”.
Tout à fait, le chantier est le lieu qui n’existe que par les compagnons et les ouvriers qui apportent leurs compétences, on a besoin de l’œil et de la main du charpentier et le chantier est le lieu qui permet au charpentier de maintenir son savoir faire et de le transmettre à des plus jeunes. Les savoirs-faire évoluent en permanence.
L’amiante et le plomb ?
Le plomb est systématique dans presque toutes les architectures. Il est utilisé dans les couvertures, les canalisations, les peintures au plomb. La pollution urbaine a entraîné des dépôts de plombs sur les façades ou même à l’intérieur des édifices. C’est un sujet propre à toutes les architectures déjà-là, pas seulement aux MH.
Dans l’architecture du 20ème, on a utilisé l’amiante dans les flocages, dans les joints, dans des colles de revêtement de sol et ces matériaux vont être trouvés dans les MH par exemple dans les menuiseries restaurées dans les années 70 avec des mastics amiantés.
Comment travaillez vous maintenant dans le contexte du confinement avec les chantiers ?
Les architectes de l’agence sont en télétravail, il y a aussi du chômage partiel. Une agence c’est un assemblage de temporalité avec des dossiers qui sont à l’étude et des chantiers. Tous les chantiers sont arrêtés. Tout le monde doit être traité avec la même considération que l’on soit architecte ou ouvrier.
Comme tout le monde j’ai dû apprendre le télétravail, les conférences téléphoniques et peut-être à en mesurer les limites. Je me rends compte que je ne peux pas me passer du studio qui doit être le lieu d’échanges entre les architectes, paysagistes, historiens.
Il est certain que nous devrons vivre sans doute différemment sans que l’on mesure exactement ce que cela signifie. Architecte c’est être dans la société, nous devons être ensemble et pas isolés des autres.
« L’architecture fonctionne de façon parallèle à la mise en scène »
Vincent Macaigne est un acteur, auteur, metteur en scène de théâtre, et réalisateur français. En 1999, il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. A côté de ses nombreux rôles au cinéma où il a été mis en scène notamment par Louis Garrel, Guillaume Brac, Olivier Nakache et Eric Toledano, il s’illustre dans les théâtres publics européens en tant qu’auteur et metteur en scène avec des pièces comme « Idiot ! » en 2014, ou « Je suis un pays » lui valent la reconnaissance du public et des critiques.
Il nous partage sa vision de l’architecture et de la mise en scène.
C’est quoi pour toi l’architecture ?
Essayer d’adapter l’espace aux hommes, à leurs besoins, à leurs goûts, de penser l’espace et le temps qu’on y passe, de penser le mouvement dans un espace et de l’organiser. C’est d’imaginer et de façonner un espace vers une façon de vivre. C’est pour cela que l’architecte varie avec les époques, je crois.
C’est quoi ton endroit préféré ?
J’adore les théâtres parce que tout peut y arriver. Vide il garde quelque chose des histoires et des aventures passées, il est chargé. Et c’est un espace souvent assez grand. Grand concrètement et dans l’imaginaire. Grand, dépouillé et prêt à accueillir.
—
En tant qu’auteur et metteur en scène, qu’est ce qui t’inspire pour concevoir un projet ?
Souvent l’espace, une idée d’un espace et d’un temps, une atmosphère, une sensation de ce qui pourrait arriver dans cet espace, l’espace est au centre. Je commence à imaginer l’accident qui pourrait arriver dans cet espace quand je l’ai visualisé et l’histoire arrive.
Est ce que d’une certaine façon tu te considères comme un architecte ?
Non, mais je pense que l’architecture fonctionne de façon parallèle à la mise en scène. C’est circulaire comme dans la mise en scène. On est obligé de commencer à travailler avec des idées qui sont parfois fausses mais qui servent à trouver la chose la plus juste. Il faut façonner sur des hypothèses et la réalité dicte la façon de modifier ses réponses à ces hypothèses.
C’est quoi, selon toi, une bonne mise en scène ?
Quelque chose qui arrive comme un accident. Qui saisit de façon émotionnelle. Qui peut déplaire ou plaire mais surtout qui se redéveloppe dans l’imaginaire avec le temps, deux jours après, une semaine après, un an après. L’impact et la mémoire. Ce sont mes deux pensées quand je travaille. L’organique et la mémoire. Le lieu, l’espace doit être traversé et bouger. Une bonne mise en scène, c’est une mise en scène qui transforme le monde, l’espace. La ville qui entoure le théâtre doit avoir changée de texture quand on ressort de la salle. Le moment a été un vrai moment infini et contenu. Une révolution
Quels sont les indices que tu vas collecter pour arriver au choix des décors ? de l’ambiance ? de la luminosité ?
Je travaille à partir des répétitions avec les comédiens. L’espace m’est inspiré par leurs gestes, leur voix, leur imaginaire. Après ces répétitions je me mets à chercher des peintures ou des photos, et dans un deuxième temps j’aime beaucoup collaborer et échanger sur ce que va être l’espace. Et quand cet espace est défini dans ma tête et j’aime passer par une maquette pour me projeter dans le spectacle et définir le projet d’une manière plus précise.
Créer une ambiance éphémère dans un théâtre pérenne. Prends-tu en compte le volume et l’architecture du théâtre dans lequel tu t’implantes ?
Oui évidemment, c’est le premier des défis, faire un décor qui colle à plusieurs théâtres de volumes différents et qui ait l’air réel à chaque fois et qui s’adapte à chaque théâtre. En France un spectacle se produit grâce aux tournées dans les théâtres partout dans le pays. Le spectacle doit être pensé de façon à être démonté et remonté. Enfin il y a aussi les spectacles qui s’inscrivent dans des décors réels, des lieux déjà existant, des églises, des cours, des hôpitaux, et c’est toujours sublime les spectacles hors les murs, où le vrai lieu devient le décor, où le spectacle se charge de la force d’un lieu véritable, ou le patrimoine architectural charge l’imaginaire et ajoute de la magie au spectacle.
Rencontres-tu des contraintes dans ta mise en scène liées à l’architecture ?
Oui bien sûr, souvent je suis amené à essayer de cacher les actes architecturaux dans les théâtres. Mon travail c’est de créer un univers propre à mes spectacles et parfois quand l’acte architectural est trop présent dans la salle de spectacle du théâtre, ça peut devenir un problème et je suis amené à cacher les murs des salles et ré architecturer l’espace pour plonger les spectateurs d’une manière plus fluide dans mon univers.
Quels conseils donnerais-tu aux architectes pour améliorer la conception des théâtres ?
Penser à la vie, à la mémoire, être humble, imaginer ce que c’est d’écouter un comédien, penser au son, penser à l’espace et à comment on regarde. Penser que le théâtre c’est une expérience pas une salle d’événementiel multitâche. C’est une salle, un endroit qui doit accueillir un millier d’histoire un millier d’accident au sens propre et au sens figuré. D accueillir en toute sécurité et avec le confort. Un endroit dangereux et en même temps complètement rassurant. Penser à la couleur noire. Parce que le noir disparaît.
Que serait ton théâtre idéal ?
Celui qu’on doit inventer, qu’on doit construire.
« Mon travail c'est de m'occuper des collemboles »
Raphaël Duroy, paysagiste et fondateur de Amare Horto depuis 2013. En latin, « Amare » signifie aimer et « Horto » jardin. Il conçoit aujourd’hui avec son équipe de nombreux jardins en apportant un soin particulier sur le respect du végétal.
C’est quoi pour toi l’architecture ?
Mon père était journaliste d’architecture. C’est un élément qui est toujours resté présent dans ma création et qui continue à l’être. Un jour, on marchait sur le canal de l’Ourcq en regardant les nouveaux immeubles près du MK2 et il m’a dit quelque chose comme “ en architecture rien ne peut être inutile”. Cette phrase m’est vraiment restée, je pense que dans toutes les formes d’art c’est extrêmement vrai. Pour moi l’architecture est une discipline où rien n’est inutile.
Je vois l’architecture derrière les arbres et non pas les arbres devant l’architecture. Ma grande image c’est Central Park où l’on voit les immeubles qui dépassent de la crête des arbres et là, d’un coup, j’entrevois l’architecture. Elle ne m’intéresse que lorsque le végétal est présent. Lorsque l’on voit des temples en Asie entièrement recouverts de ficus, que l’on est à Central Park où l’on a l’impression que les chênes sont trois fois plus grands que les buildings qui par ailleurs sont gigantesques ou même à la Villette, c’est très beau, on voit la crête des arbres et les immeubles derrière. Une architecture réussie me semble être une architecture qui s’adapte à la nature.
Quel est ton endroit préféré ?
Au niveau architectural, la vue de la ville à travers les arbres de Central Park et au niveau personnel, c’est mon atelier, l’espace où je peux être seul dans une pièce avec mon travail.
—
Qu’est ce qui t’a mené dans cette voie ?
C’est forcément une longue réponse mais le premier élément déclencheur a été d’être malade dans la vie que je menais avant. J’étais en désaccord avec le monde. Et je pense que quand on est perdu dans la vie, il faut revenir à ce que l’on se disait enfant.
Enfant, j’aimais la photo et les plantes. Mon goût pour la photo m’a mené dans le monde du cinéma. Je travaillais à la Fondation Cartier, je faisais des films d’expos, et comme ils se rendaient compte que je devenais ami avec le jardinier à force de m’intéresser au jardin, ils m’ont commandé un film sur les jardins de la Fondation Cartier.
Ma première réflexion c’était quand même qu’il fallait que je nourrisse ma femme et mon fils. C’est comme ça que j’ai commencé à passer des annonces pour tondre des pelouses.
Je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien et que c’était vraiment un très bon remède au mal dont je souffrais.
En fait, travailler avec le vivant, c’est un travail de gestation où tout commence quand nous avons fini. Et ça pour moi ça n’existe que dans le paysage, ça prend place, ça se crée par soi-même et cette connaissance m’a permis de me poser aussi beaucoup de questions sur l’état de notre planète.
Francis Hallé dit “Quel que soit votre métier, à un moment donné vous allez vous demander si vous n’êtes pas en train de perdre votre temps, et même si vous n’avez pas une activité pernicieuse. Vous pouvez être commerçant, archevêque, marin pêcheur, musicien ou médecin, tôt ou tard vous aurez l’impression de perdre votre temps. Il existe une seule exception : si vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que vous faites est bien” (cf. La vie des arbres)
Comment conçois-tu le jardin ?
Mon travail c’est de m’occuper des collemboles. C’est la faune extrêmement importante qui habite la couche de terre, l’humus, et s’ils existent c’est que ta terre est vivante et que tu peux potentiellement faire un jardin ensuite. Mon travail se résume à ça finalement, on fait des élevages de collemboles. C’est invisible mais essentiel.
Travailler un jardin, c’est avoir une compréhension scientifique précise que l’on vient ensuite poétiser. A un moment, l’ensemble des connaissances scientifiques acquises va pouvoir permettre de jouer avec. Et ce qui m’inquiète avec la nouvelle vague de paysagistes ou amateurs de permaculture ou encore l’essor de l’éducation de la plante à l’école, c’est qu’ils ne sont pas suffisamment sachants. Cela risque de faire plus de dégâts qu’autre chose. C’est comme le solfège, une fois que tu le connais, tu peux improviser, mais pas avant.
Ensuite c’est une sorte de mise en scène très réfléchie. On va choisir l’endroit où l’on a envie de partager telles odeurs, tels points de vue. Comme la composition d’un intérieur ou d’un tableau qui prendrait vie.
Et ensuite, comme a dit Alain Richert “La qualité d’un jardin s’apprécie à la sérénité de ses oiseaux” L’envers de l’endroit – éloge de l’incertitude. p.87
Sur le site d’Amare Horto, Tu as une charte très précise que tu définis uniquement dans ce que tu ne veux pas faire…
Je pense qu’on se définit par ses “non” dans la vie. On ne sait jamais ce qu’on va faire mais on sait ce qu’on ne veut pas faire.
Dans le jardin, l’agriculture ou l’architecture, si tu ne dis pas non à des pratiques absolument démocratisées, tu fais mal ton métier finalement. Dire “non, je ne fais pas du pétrole,” “non je ne retourne pas la terre” … c’est dire je m’occupe des collemboles, je me préoccupe du vivant, c’est refuser de nuire tout simplement.
On te demande souvent d’aller à l’encontre de tes principes ?
Tout le temps ! La demande qui revient le plus souvent c’est de retourner la terre, soit exactement le contraire de ce qu’il faut faire. Par exemple ; des personnes viennent d’acheter un terrain, ils ont fait construire la maison, les ouvriers ont abimé tout le jardin, ils souhaitent retourner le terrain et planter du gazon. Alors qu’il faudrait, selon le terrain, soit faire un lit de BRF (Bois Raméal Fragmenté) pendant deux trois ans, c’est beau, ça fait un champs fleuri magnifique, cela va régénérer le sol, faire revenir les collemboles, après le passage des chenilles … et à ce moment-là on peut envisager de faire un jardin. Les solutions plus rapides sont les buttes. Il ne faut surtout pas toucher la terre il faut la couvrir
Si on te commande un jardin à la française, est-ce que cela entrerait dans ton éthique ?
Tout dépend du client. Si on ancre cette démarche dans une réflexion intéressante et éco-responsable, c’est tout à fait envisageable de faire de beaux jardins à la française. Après, c’est intéressant aussi de détourner le jardin à la française pour qu’il soit plus intelligent, plus naturel et bien plus vivant. Amare Horto a expérimenté ces réinterprétations dans des jardins d’hôtels particuliers à Vincennes et ça fonctionne super bien. Il faut qu’il y ait un accord et une confiance avec le client sur les principes que je défends.
Quelles sont les grandes évolutions qui ont modifié le métier de paysagiste ?
Les grandes découvertes pour les arbres sont très récentes.
Avant 1995, on ne savait pas ce qu’était qu’un arbre. On a commencé à le savoir grâce à Francis Hallé.
Deux découvertes notoires :
Les arbres n’ont pas un génome fixe. D’une branche à l’autre, il n’y a pas forcément le même gène. Ce qui signifie que l’arbre n’est pas un individu, il n’a pas de début, pas de fin. Découverte fondamentale.
La principale source de carbone de l’arbre vient de l’air. La lumière avec l’aide de la chlorophylle est source d’énergie, mais ça on le savait déjà.
Ce que l’on sait aussi maintenant c’est que l’arbre n’a pas de programme de sénescence, pas de vieillissement cellulaire, il ne meurt que de causes extérieures à lui-même, le vent, les accidents, les glissements de terrain, les coupes humaines…
Que penses-tu des actions de végétalisations dans les milieux urbains ?
J’attends que l’on pense dans l’autre sens. Que l’on urbanise sur du végétal et non l’inverse.
A Londres, lorsqu’on voit certaines rues où les habitants se réapproprient l’espace, végétalisent leurs rues, et font planter des tomates, on commence à renverser la balance.
Dans les maisons de bambou dans la jungle, on voit que les constructions respectent le vivant et s’y adaptent sans le modifier. L’urbanisation vient sur la végétalisation. Autre exemple, la maison japonaise, est construite par rapport à son jardin et non l’inverse.
A une échelle complètement différente, on peut retrouver cette sensation au Central Park de New York où l’on a le sentiment que la ville a été construite autour du jardin.
Que penses-tu de la manière dont les architectes intègrent le végétal dans leur construction ?
Il me semble qu’il y a toujours, malgré les efforts, cette sensation que l’architecte essaye d’imposer sa supériorité sur le paysage. Je ne me suis pas encore dit en voyant un immeuble arboré que l’architecte avait vraiment compris ce qu’il faisait. Je pense à beaucoup d’immeubles qui longent le périphérique, sur lesquels on a tartiné de manière irréfléchie des arbustes.
Nous, contrairement aux architectes, on ne fait pas des dessins on fait des jardins. J’ai toujours le sentiment que les arbres plantés sont uniquement le langage du plan de l’architecte et non d’une réelle réflexion sur le vivant implanté. Il faut s’intéresser à la terre dans laquelle on va planter, donc aux bêtes, aux champignons et aux bactéries qui y vivent.
A la Bibliothèque François Mitterrand, on voit tout de suite que le concepteur du jardin avait compris tout cela. Ce qui est très réussi à la BNF c’est que le cœur du projet est un jardin protégé où l’homme n’a pas accès.
Je pense que ça a été une grosse erreur d’associer les deux métiers par le titre d’Architecte-Paysagiste alors que ce sont deux métiers et deux savoirs très distincts. Ce titre permet à l’architecte de concevoir un mauvais paysage et inversement.
Être paysagiste, cela demande d’être à la fois scientifique et poète. Et l’architecte n’a pas le savoir suffisant pour planter le bon arbre au bon endroit, d’ailleurs souvent il ne se pose pas la question.
Quel doit être le lien entre l’homme et la nature ?
L’homme doit encore trouver sa place par rapport à la nature. Les arbres et les plantes lui sont bien antérieurs. Il doit se tenir, de manière humble, à l’écart de certains processus naturels. Par exemple, lorsque nous créons des buttes c’est pour décourager le piétinement et ainsi laisser faire la nature. Jamais l’homme n’a eu une action bénéfique sur la forêt.
Y a-t-il un bâtiment qui t’as particulièrement marqué ?
Une cabane de bambou à flanc de colline quelque part dans le nord de la Thaïlande. Cabane uniquement construite en bambou, entourée de bananiers et perchée à plusieurs mètres du sol. On s’y sent comme un oiseau. Le bambou permet de voir à travers le sol et les murs et donne une atmosphère ombragée et vibrante à l’intérieur des pièces. Les cabanes sont grandes et desservent plusieurs pièces. Elles sont construites sur deux étages : l’étage inférieur qui abrite les espaces d’habitation moins nobles comme les toilettes, les ateliers avec les outils etc et au première étage les pièces de vie.
Qu’est-ce que tu rêverais de faire en tant que paysagiste ?
Il y a un projet sur lequel nous travaillons en ce moment qui me plait beaucoup. Nous travaillons pour une entreprise de recyclage de matériaux dont les locaux sont près d’Orly. Ils nous ont proposé d’aménager au milieu de conteneurs en tôle 200m2 de terre. Nous voudrions créer une forêt de 200m2 avec un amphithéâtre au milieu. Ce projet est excitant.
Mon autre rêve serait de créer un parc public.
Quelle serait la gestion idéale d’une forêt ?
D’abord, il faut bien connaître sa forêt en répertoriant les arbres, repérer les plus vieux, dégager autour d’eux pour les protéger.
Cela nécessite d’avoir une forêt la plus libre possible avec plusieurs essences. Il faudrait ensuite prélever un quota bien défini d’une certaine espèce par hectare, en fonction de son âge. On laisse les arbres s’écrouler et pourrir, cela nécessite de perdre certains arbres mais l’on sait que c’est productif.
Aujourd’hui, quelques producteurs utilisent cette méthode, mais c’est du bois qui va être réservé pour des luthiers. Ils choisissent les arbres, pendant 30 ans ils les regardent pousser et un jour ils disent on les abat.
C’est pour ça que je n’achète plus de bois dans les réseaux mais directement auprès des scieries et des producteurs.
Que penses-tu des forêts de douglas ?
Il y en a partout en France. D’ailleurs on ne parle pas de forêt mais plutôt de plantations de douglas, ça n’a rien à voir avec une forêt. On peut taper dedans, peu importe car ce n’est plus vivant. Tout est entièrement mort. En revanche c’est un très bon bois de construction, et si on veut être responsable il faut acheter du douglas français. Parce que ces plantations existent, autant les utiliser.
Mais si tu achètes ce bois, cela ne va pas participer à la pérennité du commerce de ces plantations ?
En fait après la seconde guerre mondiale, la France n’avait plus de bois, tout avait été coupé et massacré. Nous avions besoin de produire pour reconstruire le pays. Nous découvrons un bois génial, c’est le plus grand pin du monde il tient à l’extérieur, à l’eau, il fait des poutres parfaitement droites et magnifiques de 30m de haut.
L’État pousse à la plantation des douglas pour relancer l’économie. On a bousillé des endroits où il n’y avait pas de forêts. C’est le cas du Morvan. Le Morvan c’était des bocages et des pâturages que l’on a remplacés par des forêts de douglas. Et supprimer les bocages c’est une catastrophe pour la faune. Les gens du Morvan en sont fous. Ça fait 60 ans qu’ils sont furieux.
Pour répondre à ta question ; étrangement le douglas français n’est pratiquement pas exploité par les grosses entreprises donc lorsque l’on achète ce bois, on est quasiment sûr de travailler avec des petites scieries. Et si on travaille avec une bonne scierie responsable, des bons producteurs qui ont acheté ces parcelles et qui à terme souhaitent les transformer en des parcelles plus responsables, il faut l’encourager et en acheter.
Ce qu’il ne faut pas faire c’est de continuer à autoriser les entreprises à planter un plan au mètre linéaire en ligne sur des espaces gigantesques.
A long terme, l’objectif étant de faire disparaître ces plantations de douglas.
Le bois français qui pourrait remplacer le douglas dans le milieu de la construction, c’est le chêne ?
Oui mais c’est plus cher et il n’y en a pas suffisamment. Je travaille régulièrement le chêne mais il faut que mes clients acceptent de payer trois ou quatre fois le prix. L’avantage aussi avec le chêne, c’est que la poutre est deux fois plus fine que celle du douglas car ses cernes sont beaucoup plus denses et solides. Une autre différence, dans les pins il n’y a ni bois de cœur ni aubier, le bois est le même partout.
Qui sont ceux qui t’inspirent ?
Francis Hallé, botaniste, biologiste et dendrologue français. Auteur de Eloge de la plante, 2014, Plaidoyer pour l’arbre, 2005.
Alain Richert, Architecte-paysagiste et enseignant. Auteur de L’envers de l’endroit, éloge de l’incertitude, 2015. Au-dessus des Parcs et Jardins de France, « une anthologie de toutes les typologies possibles de jardins dans l’Hexagone ».
Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain français. Selon Gilles Clément, le jardin en mouvement est un « état d’esprit » qui « conduit le jardinier à observer plus et jardiner moins. À mieux connaître les espèces et leurs comportements pour mieux exploiter leurs capacités naturelles »
Akira Miyawaki, botaniste japonais expert en écologie végétale et rétrospective, spécialiste des graines et de l’étude de la naturalité des forêts. Auteur de The Healing Power of Forests: The Philosophy Behind Restoring Earth’s Balance With Native Trees, avec Elgene Owen Box, 2007
Bruno Sirven, Géographe spécialisé dans le domaine du paysage et de l’environnement. Auteur de Le génie de l’arbre, 2016.
